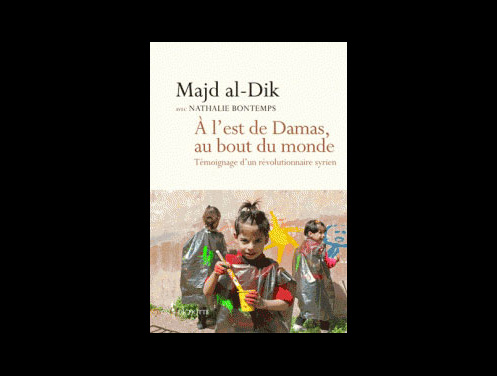A l’est de Damas, au bout du monde – Témoignage d’un révolutionnaire Syrien... Bouleversant, troublant, dérangeant… Les qualificatifs élogieux pleuvent autour de ce livre écrit par Majd al-Dik, activiste pacifiste syrien.
Ce n’est pas vraiment ce que j’ai ressenti. Je n’ai pas eu les tripes retournées d’émotion. Ce livre m’a plutôt mise en colère. Dire que l’on est profondément perturbé par ce récit est un foutu mensonge. Une malhonnêteté journalistique de Bisounours qui repeint avec l’esprit et la bonne conscience ce qu’elle nie avec le cœur. Car au fond, on s’en contrefout de la Syrie ou en tout cas, elle ne suscite en nous pas plus ni moins que cet intérêt distant dont on a fait preuve à l’égard de la Libye, de l’Iran, de l’Afghanistan ou de l’Irak, et jamais au point qu’un témoignage d’un Libyen ou d’un Irakien nous révolutionne. Faut-il rappeler notre manque d’empathie avec les quelques trois cent morts lors du récent attentat à Bagdad ? Analyser la situation d’un pays en guerre, le pourquoi du comment et le comment du pourquoi, dans un café à Saint-Germain des Près ne coûte pas cher. Que connaît-on de la richesse culturelle de tous ces pays que nos va-t-en guerre en costard-cravate détruisent d’un claquement de doigt mortifère et reconstruisent à coups de marchés juteux pour leurs intérêts – la maladie de l’Occident, la guerre étant leur produit phare – en nous glissant d’un sourire satisfait qu’ils favorisent ainsi l’emploi à l’intérieur de nos frontières ? Sait-on ce que ces pays que l’on chapeaute de manière erronée du terme arabo-musulman, ont apporté à notre culture occidentale ? Pour la plupart d’entre nous, la réponse est non. On prend conscience de leur réalité quand ils sont dans la merde. Les bombes, la faim, les champs de ruines, les bateaux qui tanguent sous le nombre des migrants, les massacres, les images en boucle sur nos écrans de télé et les réseaux sociaux. Nos yeux se dessillent alors, bien qu’on les regarde en voyeurs ébahis. Pour le reste, on fabule politiquement et émotionnellement dans la perception que l’on a de la guerre en général, dans le cas présent en Syrie, puisque l’on ne la vit pas et que nos opinions sont structurées par des informations contradictoires ou mensongères, somme toute invérifiables par les citoyens lambda que nous sommes. De plus, notre mémoire ô combien volatile, ne se souvient de la Syrie que lorsque l’actualité nous envoie les faire-parts de sa nécrologie morbide dans le sillage des frappes aériennes effectuées par les pays de la coalition. L’Occident a un sérieux problème d’amnésie historique et ne se rappelle que de ce qui l’intéresse quand ça l’intéresse.
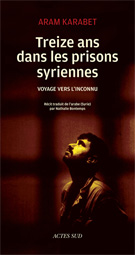 Il faut vraiment être un demeuré mental pour ignorer qu’une guerre, quelle soit civile ou non, engendre toute la gamme possible et inimaginable des comportements déviants dont l’humain est capable dans le pire. Dans cette société relativement peinarde de Bisounours où l’on vit en paix depuis trois générations, grâce à ces conflits extérieurs programmés que nous entretenons, on a eu tout le temps de prendre approximativement la température réelle de cette horreur inacceptable, quels qu’en soient les acteurs, grâce à la littérature et aux documents de guerre qui sont pratiquement le seul thermomètre dont nous disposons. Mais de là, à en éprouver toutes les nuances, les sentir dans notre chair, n’en pouvoir plus de douleur, de souffrance, de peine, d’être ramoné par l’émotion pour finalement hurler « ça va, je sais, j’ai compris », le cul vissé sur une chaise en lisant un bouquin au prétexte qu’il a été écrit par quelqu’un qui l’a expérimenté dans sa peau, c’est se foutre de la gueule du monde, et ce d’autant plus, qu’il y a peu de probabilités que l’on change d’attitude si par hasard un réfugié, ici Syrien, venait à croiser notre chemin. En outre, je m’interroge : pourquoi le livre de Majd al-Dik suscite un intérêt que n’ont pas provoqué, ou en tout cas fort différemment, Treize ans dans lesprisons syriennes d’Aram Karabet ou Eloge de la haine de Khaled Kalifa , publiés précédemment en France en 2013 et 2011?
Il faut vraiment être un demeuré mental pour ignorer qu’une guerre, quelle soit civile ou non, engendre toute la gamme possible et inimaginable des comportements déviants dont l’humain est capable dans le pire. Dans cette société relativement peinarde de Bisounours où l’on vit en paix depuis trois générations, grâce à ces conflits extérieurs programmés que nous entretenons, on a eu tout le temps de prendre approximativement la température réelle de cette horreur inacceptable, quels qu’en soient les acteurs, grâce à la littérature et aux documents de guerre qui sont pratiquement le seul thermomètre dont nous disposons. Mais de là, à en éprouver toutes les nuances, les sentir dans notre chair, n’en pouvoir plus de douleur, de souffrance, de peine, d’être ramoné par l’émotion pour finalement hurler « ça va, je sais, j’ai compris », le cul vissé sur une chaise en lisant un bouquin au prétexte qu’il a été écrit par quelqu’un qui l’a expérimenté dans sa peau, c’est se foutre de la gueule du monde, et ce d’autant plus, qu’il y a peu de probabilités que l’on change d’attitude si par hasard un réfugié, ici Syrien, venait à croiser notre chemin. En outre, je m’interroge : pourquoi le livre de Majd al-Dik suscite un intérêt que n’ont pas provoqué, ou en tout cas fort différemment, Treize ans dans lesprisons syriennes d’Aram Karabet ou Eloge de la haine de Khaled Kalifa , publiés précédemment en France en 2013 et 2011?
Chroniquer cet ouvrage pour Mediapart, c’est à tous les mots se jeter dans un piège et risquer le lynchage virtuel. Dans ce conflit, il y a tellement de gens prêts à mourir pour des idées et des militantismes, avérés ou obscurs, des convictions et des opinions dont on ignore tout ou presque, que donner un avis péremptoire sur A l’est de Damas relève de l’impudeur. Savoir distance garder est une nécessité et un devoir d’honnêteté. Mais affirmer que le point de vue du protagoniste et auteur de ce récit serait la seule vérité, est tout aussi irresponsable. C’est à tous les coups alimenter les protestations du camp opposé – et ils sont multiples – qui ne manqueront pas de dire : non, vous avez tort, c’est un vendu, un traître, etc… et peut-être de m’attirer un flot de commentaires injurieux. Il faut prendre des précautions quand on touche à l’humain, d’autant plus quand on aborde ce qu’il y a de plus ambigu et de plus sombre en lui, dès lors qu’il est convaincu que la mort de l’Autre est le prix de sa propre liberté.
La première partie du livre est consacrée à l’enfance et l’adolescence de l’auteur. Un village paisible, Rihané dans la Ghouta orientale, deux frères et une sœur, un olivier pour toise, la pauvreté, les disputes incessantes de ses parents et l’école comme échappatoire. A dix ans, le voilà qui travaille dans les vergers pour payer ses fournitures d’école à la prochaine rentrée et ainsi, chaque été. A quinze ans, il est admis au lycée, mais ne peut y aller, le coût du transport quotidien étant une ruine pour le budget familial. Il ajoute alors à sa liste d’emplois quotidiens, un boulot dans une usine et sur les chantiers. Le Croissant rouge sera son opportunité, où il entre grâce à son oncle qui est le président de celui de Douma, région dont est originaire Majd al-Dik. Il y fait un stage de secourisme qui débouche sur un emploi fixe, passe son bac en candidat libre tout en travaillant, s’inscrit à la faculté de droit, obtenant alors le report de l’obligation de service national. On est en 2006. Pendant qu’il aide les réfugies Libanais qui ont fui les bombardements israéliens, puis participe « à des stages de soutien psychologiques destinés aux enfants irakiens qui avaient afflué suite à l’invasion américaine de 2003 », pendant qu’il goûte à sa liberté tout neuve loin du foyer familial et prend tranquillement sa vie en main jusqu’en 2011, les révolutions populaires grondent en Égypte, en Tunisie, en Libye et au Yémen. Leur écho suscite en lui le vague désir que « cela arrive chez nous ». Mais habitué comme tous les Syriens à vivre dans « un état policier, où même les paysages arboraient des allures militaires », où « par crainte des représailles la rue se garde bien de commenter » les rumeurs « répandues officieusement », autant dire que sa conscience politique est quasi nulle. Majd al-Dik ne croit pas un instant qu’il soit possible de renverser le clan Assad. Il « chasse même toutes ces idées » de son esprit « en allant au travail ». Les reportages télévisés sur ces Printemps arabes lui font néanmoins « entrevoir la force que peuvent acquérir ceux qui se rassemblent ». Les vidéos sur Facebook et Youtube du réseau Cham, documentant les prémices de la révolution syrienne, catalyseront son éveil. La révolution syrienne de 2011 est aussi ce qui lui permet de sortir d’un certain anonymat, de donner un sens à sa vie, de gagner les galons d’une confiance certaine en lui-même et de minorer le ressentiment et la frustration qui l’animent.
Quand le pouvoir commence à décliner parce qu’il y a dégénérescence, trop d’abus, de répressions et de provocations, ajoutés à l’arrogance de ses élites civiles et militaires et à tous les compromis qu’il fait avec l’Occident, la roue tourne et vient le moment propice, souvent spontané, où la baraka du peuple peut s’exprimer en un vaste soulèvement populaire. En Syrie, il débute en février 2011. Le 15 mars, des manifestations massives, notamment à Deraa, sont durement neutralisées. Le 25 mars, Majd al-Dik participe à sa première manifestation pacifique à Douma. Elle sera suivie de beaucoup d’autres, chaque semaine après la prière du vendredi, férocement réprimées par les forces de sécurité, flics, militaires et sniper,s sans oublier les nombreux délateurs qui balancent leurs compatriotes aux autorités. Le jeune homme se fera arrêter en avril. Emprisonné et torturé, il est libéré en automne de la même année et s’engage alors dans les aides médicales, sous la bannière du Croissant Rouge. Il sait désormais qui est son ennemi.
La seconde partie du livre est le récit de tous les événements qui ont suivi et précipiteront le peuple syrien dans la guerre civile, entre pro et anti Assad. Chacun, que ce soit Bachar al-Assad et ses partisans ou les multiples chefs de guerre rebelles, islamistes ou non, a une idée précise de ce que doit devenir la Syrie. Les dissensions sont nombreuses et la méfiance de règle. D’une manière ou d’une d’autre, chacun entend bien avoir sa part du gâteau qui, pense-t-il, lui revient au nom d’intérêts bassement terre à terre, entre pouvoir et fric, religions et charia, qui n’ont rien à voir avec le bien-être du peuple syrien . Mais la guerre que nous raconte Majd al-dik, la vision et l’analyse qu’il en a, ne peuvent qu’être propagandistes puisqu’il y défend son point de vue, entaché de manichéisme. Penser, comme s’attache à nous en persuader l’auteur, qu’il y a d’un côté, les bons, les gentils et nobles rebelles romantiques, et de l’autre, les méchants, les machines humaines de guerre d’Assad, serviteurs appointés d’un régime ultra-répressif, est une vue de l’esprit. Tous des salauds, sauf nous ?
Si Majd al-Dik insiste et détaille les atrocités indubitables commises par le régime et ses sbires, il minimise, voire excuse, celles perpétrées par les nombreuses factions d’opposition, d’obédience politique ou islamiste, dont Daesh, à l’unique motif qu’ils luttent unanimement contre Assad, géniteur supposé de tous les maux syriens. Faut-il rappeler à Majd al-Dik qu’Amnesty International dénonce les violences commises depuis 2011 (enlèvements, viols, meurtres, tortures, exécutions) par ces groupes islamistes dont il tempère les exactions ? Ou l’auteur est hallucinant de naïveté ou il s’arrange avec la réalité pour nous faire avaler la pilule de la victimisation des « bons », des rebelles. Comment croire, alors que « chaque formation a commencé à développer, aux côtés du volet militaire, un volet politique » qui « se devait d’être en accord avec les orientations du financeur à l’étranger. », qu’elles n’obéissent qu’au rêve utopique d’une révolution démocratique ? Si l’argent n’a pas d’odeur, les armes, elles, en ont une. Et le combat contre le régime d’Assad semble plus relever de la compétition entre chefs de guerre, chefferies tribales et religieuses que de la solidarité entre citoyens d’un même peuple. L’Occident n’est pas en reste dans cette boucherie programmée. Et on ne peut qu’être d’accord avec la constatation qu’il fait dans l’épilogue, à savoir que les puissances occidentales, avec un opportunisme écœurant de cynisme, bouffent à tous les râteliers de cette guerre.
Mais, et j’aurais aimé qu’il le fasse, il se garde bien, comme tant d’autres, d’aborder la responsabilité du peuple syrien. Accepter, supporter et subir une dictature suppose un terreau psychologique et anthropologique particulier, comme Elie Faure l’a magistralement expliqué dans Découverte de l’archipel. Avoir les neurones confits de soumission et de collaboration depuis un demi siècle par le tandem Assad père & fils, ce n’est pas rien. Le formatage auquel l’Islam soumet, dès l’enfance, 70% du peuple syrien n’explique pas tout. J’aurais aimé également qu’il soit plus explicite sur la manière dont il est arrivé en France et qu’est-ce qui avait rendu possible le fait qu’il obtienne rapidement des papiers et que moins d’un an et demi après son arrivée (25 décembre 2014), il publie un livre (10 mars 2016), alors que tant d’autres de ses compatriotes, tout aussi brillants et courageux, rament depuis des mois quelque part en France, à la recherche de cet humanisme au nom duquel Majd a crée l’association Sources de vie pour venir en aide aux enfants et aux femmes en Syrie.
Les faits relatés sont poignants. La famine, arme de destruction massive de Bachar al-Assad, les bombardements, les mortiers, les coupures d’électricité, d’eau, les snipers, la mort qui n’a plus le temps de compter ses trophées, les corps intacts des victimes du sarin à Zamalka, arme chimique dont les instances internationales – il faut le souligner – se sont bien gardées d’attribuer la paternité à l’un ou l’autre des belligérants, le sang, les cris, le rien qui remplace le tout et avec lequel on doit pourtant arriver à faire quelque chose… Tout est terrible dans cette Ghouta Orientale qui ressemble à tant d’autres théâtres bellicistes de par le monde. Et puis ces moments fugitifs de bonheur, un regard, la saveur d’un thé partagé, une main qui se tend vers une autre, un rire, un môme qui joue au ballon, ces petits riens d’un ordinaire enfui qui vous réconcilient pour un instant seulement avec l’humain.
Néanmoins, ce livre donne de la guerre en Syrie, même si les faits relatés sont imprégnés d’une douleur indicible, l’impression d’un immense bordel où chacun avance ses pions, Occidentaux inclus, et essaie de tirer la couverture à son avantage, les uns de plus en plus rares au nom de la liberté, les autres, excellemment armés et financés, au nom d’Allah et qui, eux, donnent la nette impression de rouler uniquement pour Lui. Cependant je n’adhère pas à l’analyse qu’en fait l’auteur. Quand il parle de rebelle modéré, je ne le crois pas. La guerre n’a jamais rien de modéré. Quand il fait silence sur leurs crimes aussi dégueulasses que ceux d’en face (attentats, exécutions sommaires, etc.), le plus récent étant la décapitation d’un môme de treize ans par le groupe Noureddine al-Zinki, qualifié justement de modéré, ainsi que sur tous les viols dont sont victimes les femmes et les fillettes dont la peur et la douleur se fichent bien de savoir à quelle tendance nauséeuse appartient le sexe qui leur vole leur intimité, je m’interroge sur sa sincérité et le propos de son aveuglement. Nous prendrait-il pour des cons ? Ou alors, il nous faut admettre que toutes les informations dont on dispose, sont erronées, voire trafiquées.
Ce que je sais, c’est qu’en temps de paix, la folie humaine s’amenuise et on redevient des individus plus ou moins acceptables. En temps de guerre, elle se libère, souvent pour des raisons complètement tribales : je veux le terrain de mon voisin, je viole sa femme, je le dénonce, je le tue et je le fous dans une fosse commune, parce que l’absence de lois me le permet. C’est ce que ce livre ne dit pas, mais que par ses non-dits, on peut aussi deviner d’autant mieux que nous l’avons fait durant la seconde guerre mondiale avec les Juifs, pour exemple le Vel D’hiv et la collaboration des industriels français avec les entreprises nazies . Un processus de déshumanisation est à l’œuvre sous nos yeux. Majd al-Dik n’y échappe pas . Peu à peu, une haine anesthésiante et dévastatrice le contamine : « la haine envers les assassins… mon angoisse s’est changée en haine… je ne parvenais plus à ressentir autre chose que la haine de l’armée ou du régime… j’étais devenu taiseux et, si je parlais c’était avec nervosité, rempli de haine et de peur.. » Et quand on a la haine au point d’annihiler la moindre émotion, si les circonstances s’y prêtent ou que l’on en a les moyens, quoique l’on s’en défende, on peut facilement passer à l’acte. Nul n’est un ange en temps de guerre.
Cette horreur corrosive, exponentiellement inventive, dont parle Majd al-dik est universelle. Selon l’édition 2016 du classement Global Peace Index, seule une dizaine de pays sont en paix actuellement. Si l’on mettait l’Irak, l’Afghanistan, le Yémen, la Libye, la Somalie, le Mali, la Palestine, etc., dans un milk shake et que l’on agitait, on aurait une image assez juste de la folie humaine. Dans toute guerre, on se heurte à cette immuable dualité, d’un côté les collaborateurs et de l’autre, les victimes. Les premiers sont tous à mettre dans le même sac, car ils répondent tous à la même hégémonie, celle de l’horreur donnée et reçue, peu importe le camp. Les secondes errent dans les ruines, pour celles relativement rares qui ont fait le choix délibéré de rester pour aider toutes celles et ceux qui ne peuvent pas partir. Elles errent également sur les routes. Elles s’enfuient, éperdues, hagardes, sans rien d’autre que leur peau sur le cul,pour que leurs enfants, leur famille, ceux qu’elles aiment plus que leur vie, ne meurent pas de l’imbécillité incurable des êtres humains. Subsistant tant bien que mal, la peur et le désespoir aux tripes, elles fuient les deux camps, juste pour survivre cahin-caha dans un monde qu’elles souhaitent désespérément meilleur. Il n’y a plus d’idéologie, plus de religion, plus rien, juste la trouille de se prendre une balle dans la peau ou qu’une bombe vous raye de la face de la terre. C’est aussi tout ce que raconte et ne dit pas A l’est de Damas.
Ce qui est terrible, et mon cœur saigne, ce n’est pas la guerre. Ce qui est terrible est notre passivité voyeuriste devant l’horreur, tant qu’elle ne nous enlève pas le pain de la bouche. « Il faut bien que la vie continue » comme le martèle monsieur Tout-le-monde. De la même manière qu’on sauve les phoques et les baleines, on prétend sauver aujourd’hui les Syriens. Mon cœur saigne parce que la culture arabo-musulmane est une vieille histoire d’amour amorcée, il y a des années avec la belle rencontre de Maxime Rodinson, par la lecture de nombreux auteurs édités par les éditions Sindbad, au rang desquels Attar, Rûmi, Râzi, Avicenne et Ibn Arabi, ou d’autres comme Corbin, Berque, Miquel, Massignon, Lewis ou Sohravardi, etc., sans oublier l’inénarrable Mullah Nasruddin. L’Occident se glorifie fréquemment et abondamment de ce qu’il a apporté aux autres cultures, sans jamais aborder son corollaire, à savoir ce qu’il leur a spolié ou nié ! Or la culture arabo-musulmane a grandement enrichi notre culture occidentale hégémonique. Le meilleur des arts martiaux devrait être la culture
J’apprécie, comme vous sans doute, ces petits riens, un café, une clope, un rayon de soleil, le sourire d’un gosse, un bon repas ou le cocon familial. Mais je n’oublie jamais que loin de moi, une femme, un homme ou un enfant peut-être, donnerait n’importe quoi pour vivre un tel instant. Cette femme est peut-être assise dans sa salle à manger. Là-bas. Elle a préparé le repas. Son mari et ses enfants le partagent avec elle. Un obus, un autre. La pièce s’éventre dans un souffle de poussière. Du sang gicle de son bras déchiqueté. Sous les gravas, son mari et ses enfants .
Non, ce n’est pas du tout la même chose de gérer des guerres depuis nos écrans de télé ou depuis la Bourse à coup de pétrodollars, d’envoyer un missile depuis le porte-avion machin ou de télécommander un drone. On n’en mesure pas les conséquences. On n’en voit pas les dégâts, surtout quand on digère l’info, au chaud et le ventre repu. Qu’on l’admette ou non, nous sommes tous impliqués dans cette guerre, là-bas, au bout du monde, en Syrie. Nous en sommes aussi tous responsables. Par ignorance, par laxisme et pour donner par le vote, tout pouvoir à la mafia politique et à leur clique.
A l’est de Damas, au bout du monde de Majd al-Dik, d’une certaine manière, nous le rappelle amèrement.
© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott – 30 juillet 2016
Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5
du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.
A l’est de Damas, au bout du monde – Témoignage d’un révolutionnaire Syrien, de Majd al-Dik,
traduit par Nathalie Bontemps,
Editions Don Quichotte, Paris, 2016.
Publié également sur Médiapart, Des livres et nous.
![]()