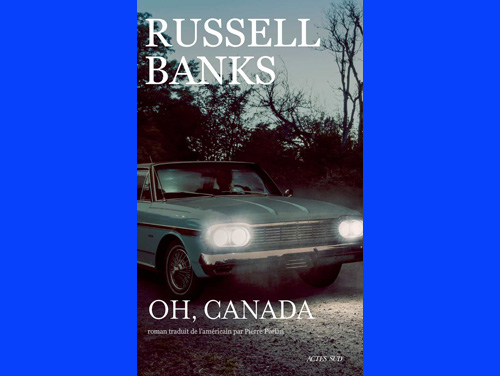Quand le cœur pleure ce qu’il a perdu, l’esprit rit sur ce qu’il a trouvé.
Proverbe soufi
Une « voix désincarnée qui émerge d’une obscurité vide pour s’adresser à une obscurité incarnée..» Un visage, plutôt le profil d’un visage, détouré par la lumière d’un projecteur. les ombres chinoises furtives de l’équipe de tournage se dessinent dans ces ténèbres artificielles, mais il ne les voit pas. Il ne les entend même pas. Juste attentif à la présence de sa compagne, Emma, une femme qu’il aime sans l’aimer, un peu comme on s’habitue à la présence quotidienne d’un bon vieux fauteuil. C’est pour elle qu’il est là. Si perclus de douleur que son intensité l’a fait disparaître, avec ou sans morphine. Et pour sa propre mort. Elle est là, elle veille dans son corps qui n’est plus qu’une enveloppe qui sent l’urine, la sueur et la médecine de l’ultime. Mais il n’a pas peur. Il désire juste qu’elle le laisse dans un dernier souffle passer au propre sa vie mensongère. A l’instar des documentaires qu’il a tournés, le voilà impatient de traquer à son tour dans la vérité des faits, l’envers du décor de ses actes. Ses collaborateurs n’ont rien à faire de ses aveux brouillons. Ils sont là pour faire un film, une success story, un happy end de la vie aventureuse et politiquement impliquée du Léo Fife public. Ce qu’ils attendent, c’est l’histoire, l’anecdote qui fera le buzz. Sa rencontre avec Dylan, par exemple. Et encore mieux son aide apportée aux jeunes Américains qui refusant de partir mourir au Vietnam, se réfugièrent au Canada, d’où le titre français Oh Canada du roman de Russell Banks. Soit dit en passant le titre original Foregone était nettement plus fort. Ce terme signifiant « prévisible, couru d’avance » colle mieux, à mon avis, au récit de l’existence de Fife qui se résume à une fuite en avant permanente, pitoyable de lâcheté. Bien qu’il exige qu’Emma en soit le témoin silencieux, celle-ci, préoccupée par la rapide détérioration de l’état de son mari, écoute d’une oreille distraite son propos qu’elle assimile aux divagations d’un mourant.
Etrange soliloque que celui de Léonard Fife. Il n’est pas là pour répondre aux « vingt-cinq questions conçues – par son équipe pour l’amener – à faire le genre de remarques provocatrices et parfois profondes » qui bâtirent sa réputation à l’Université Concordia de Montréal. Non. Il est là pour se dire. Enfin ! Dire ce qui fut et dire ce qui ne fut pas. Réinventer le narratif de sa propre vie. Se défaire de sa sourde culpabilité. Ni dans la fiction, ni dans la vérité non plus. Juste dans un entre-deux où il attend que lui soit accordée l’absolution. « Il a l’intention de partir en étant celui qui aime et qu’on aime. Sans secrets. Sans mensonges. Ce n’est pas de l’héroïsme. C’est simplement la fin d’une vie de lâcheté. » Aura-t-il réussi son dernier tour de piste, au moment de rendre l’antenne ? Au lecteur d’en juger.
Toujours est-il que le véritable intérêt de ce roman, qu’un imbécile marketing littéraire s’accord à dire testamentaire, son auteur étant octogénaire, est dans ses marges, bien loin de celles éculées de la vieillesse, des dégâts du temps et de la mort. Il aborde un thème dans lequel nous nous vautrons tous allègrement actuellement, que ce soit au niveau étatique, politique, économique, sanitaire, scientifique, médiatique, religieux, idéologique, culturel : le Mensonge. Et il est fascinant de voir comment le mensonge modèle l’esprit, le « Mens » en latin, au collectif comme à l’individuel, engendrant un hallucinant déficit affectif, intellectuel et spirituel.
Au terme de sa vie, la prégnance de cette évidence saute à la figure de Fife. Il va mourir sans identité. Personne ne saura jamais qui il était réellement. Par chance, « c’est le cancer qui lui a donné la liberté de creuser et de révéler le mensonge. » C’est plus exactement l’imminence de sa mort qui le pousse à se confesser. « Plus personne à impressionner. Rien à perdre ou à gagner. Il n’a plus d’avenir, et sans avenir, il n’y a rien que son passé puisse saboter ou défaire. » Alors, il remet ses souvenirs sur le métier à tisser de la mémoire, sans vouloir assumer que tout a un sens et une cause.
A tant s’être perdu de vue, à tant s’être éloigné de son moi profond, il se fabrique un nouveau mensonge. On ne redevient jamais ce que l’on a perdu. « Chaque mensonge est un poison ; il n’y a pas de mensonges anodins. Seule la vérité est sûre. Seule la vérité me console – c’est le seul diamant incassable. », écrivit Tolstoï, qui fit dire à Anna Karénine : « Quand tu comprends que tu peux mourir aujourd’hui ou demain et que rien ne restera, tout te semble néant ! »
Russell Banks calque sa narration sur les souvenirs kaléidoscopiques de Léo, dédaignant la logique d’une chronologie, ce qui fait sens car une vie n’est jamais linéaire, mais qui a parfois le défaut d’enliser le récit. Mais qu’importe ce que l’on pense de la narration, du style et du tutti quanti littéraire, l’intérêt de Oh Canada est dans ce questionnement qui au décours de la lecture, m’a également assaillie.
 Combien de fois ai-je menti ? Dans quelles circonstances ? Comment ? A qui ? Pourquoi ? Comment arrivé au bout du bout de la vie, perçoit-on notre existence ? Où commence sa fiction ? Où commence sa vérité ? Qu’est-ce que l’on nomme réalité puisque tous comptes faits, tout est illusion ?
Combien de fois ai-je menti ? Dans quelles circonstances ? Comment ? A qui ? Pourquoi ? Comment arrivé au bout du bout de la vie, perçoit-on notre existence ? Où commence sa fiction ? Où commence sa vérité ? Qu’est-ce que l’on nomme réalité puisque tous comptes faits, tout est illusion ?
Bref entre le mensonge pieux et celui par omission, on ment comme on respire. Mais jamais par conviction. Qui avouerait qu’il est devenu soldat parce qu’il aime tuer ? Quel prêtre confesserait qu’il est entré dans les ordres pour mieux habiller son homosexualité ou sa pédophilie ? Quel parent reconnaîtrait aimer plus un enfant qu’un autre ? Quel fils, quelle fille admettrait qu’il place ses vieux parents en Ephad, non par affection prudente mais parce qu’ils lui ont toujours fait honte ? Ou qu’il reste dans son boulot desséchant mais bien payé, parce que c’est plus facile ? La liste est longue, aussi longue que chacune de nos entourloupes mentales. Ce sont des petits arrangements entre Soi et soi, coutumiers. Si coutumiers que l’on finit par les faire siens. Et même y croire !
La mémoire est mensonge et le mensonge est mémoire. Nous sommes des êtres étranges et étanches. Nous ne partageons rien, si ce n’est des instants de vie tressés d’heures, de semaines, de mois ou d’années, de sentiments, de doutes, de peurs et de lâcheté aussi, que le souvenir rhabille à sa façon pour chacun d’entre nous. Le mensonge, exception faite de la volonté intentionnelle de tromper, est un subterfuge auquel on a recours, souvent inconsciemment, par besoin naturel, quasi vital de survie spirituelle, voire comme Léo Fife, pour transcender notre médiocrité et éluder une existence ordinaire pour une autre plus exaltante, moins terne. Vivre avec notre noirceur intime tissée d’hypocrisies et de multiples trahisons, en apparence anodines, est un exercice auquel nous sommes tous rompus. La loyauté que nous devons d’abord à nous-mêmes s’y dérobe avant de s’y dissoudre, à tel point qu’aujourd’hui elle a cessé d’être une vertu cardinale pour devenir obsolète.
Que valent une vie et l’éthique d’une œuvre bâtie sur un mensonge ? Oh Canada s’ouvre sur un vers de Pessoa qui pourrait tout aussi bien le conclure : « au souvenir de qui je fus, je vois un autre… » Et au fond quelle importance, puisque le temps efface ce que nous avons été comme ce que nous n’avons pas été ou su être.
© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott – 23/10/2022 .
Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle,
ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.
Biographie de l’auteur
 Russell Banks est un écrivain américain né le 28 mars 1940 dans le Massachusetts. Il a passé son enfance dans le New Hampshire dans un milieu extrêmement modeste. Après des études à l’université il voyage, passe même quelque temps en Jamaïque. Il a écrit des romans, des nouvelles et de la poésie. Son œuvre a été traduite en vingt langues. Il enseigne actuellement la littérature contemporaine à Princeton. Depuis 1998 il est membre de l’Académie américaine des Arts et Lettres.
Russell Banks est un écrivain américain né le 28 mars 1940 dans le Massachusetts. Il a passé son enfance dans le New Hampshire dans un milieu extrêmement modeste. Après des études à l’université il voyage, passe même quelque temps en Jamaïque. Il a écrit des romans, des nouvelles et de la poésie. Son œuvre a été traduite en vingt langues. Il enseigne actuellement la littérature contemporaine à Princeton. Depuis 1998 il est membre de l’Académie américaine des Arts et Lettres.
Ses écrits sont parcourus par deux grand thèmes : la recherche de la figure paternelle et la description du monde des petites gens croulant sous le poids d’une vie quotidienne dure et pauvre ou de la tragédie. Russell Banks est très actif politiquement, n’hésitant pas à critiquer ouvertement son gouvernement (il a pris position contre l’intervention en Irak et contre le Patriot Act). En février 1998 et jusqu’à 2004, il succède à Wole Soyinka en devenant le troisième président du Parlement international des écrivains créé par Salman Rushdie. Il est aujourd’hui le président fondateur de Cities of Refuge North America, qui s’est donné pour mission d’établir aux États-Unis des lieux d’asile pour des écrivains menacés ou en exil (Wole Soyinka et Salman Rushdie sont parmi les vice-présidents).
![]()