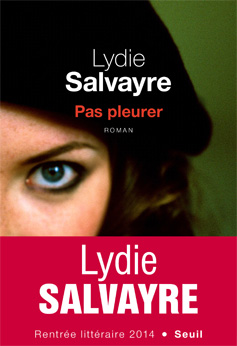Ni un bon livre, ni un mauvais livre. Juste un livre raté dès le titre sibyllin, Pas Pleurer de Lydie Salvayre. Et pourtant, l’entreprise était belle, noble même. Raconter la guerre d’Espagne, pas la romantique qui fit accourir des quatre coins du monde des jeunes hommes et femmes prêts à en découdre avec le fascisme et ses sbires, persuadés que la quête d’un monde meilleur se trouve toujours dans des circonstances secouant d’autres pays que le leur. Non raconter celle qui inonda comme un mauvais sang l’Espagne rurale, celle de Montse (Montserrat Monclus Arjona et mère de l’auteur) et de son frère José, celle de leurs parents, paysans pauvres et besogneux, qui ne connaissaient de l’horizon que celui où se découpait la silhouette des oliviers. Une terre rude, sèche, embaumée parfois par le parfum des amandiers, où la poussière est l’amante du vent et où le soleil signe autant de victoires que de défaites. Cette terre dont les sillons âprement travaillés par leurs mains rudes appartenaient à de grands propriétaires terriens – tel ce Don Jaime Burgos Obregón de Pas pleurer, époux d’une femme désœuvrée et hystérique et père d’un fils bâtard, Diego, qui revanchard pathologique par abandon paternel et maternel, deviendra communiste non par conviction sinon pour avoir une existence. Des « terratenientes » dont la richesse émargeait la puissance despotique, qui se fichaient comme d’une guigne de leurs journaliers esclaves mais ne dédaignaient pas culbuter leurs jeunes filles. Ne priaient-ils pas, tout comme eux, le même bon Dieu, le dimanche à l’église, eux devant avec leurs bancs attitrés et les pauvres, la lèpre de leur fortune, derrière, assis ou debout, les femmes d’un côté et les hommes de l’autre, et veillant sur ce troupeau hétéroclite de toute son âpreté de bigote desséchée, une Doña Pura.
J’en ai connu de ces mauvaises viandes, aristocrates ou non, qui font toujours résonner de leurs commérages vipérins et frustrés les rues de ces villages que l’on imagine aisément aujourd’hui, parce que gorgés de soleils touristiques, paisibles de toute éternité. Hier pourtant n’est pas oublié. Le feu couve sous les cendres du ressentiment et de l’amertume des vengeances accomplies ou non. Quelques allusions et sous-entendus et les bûchers sont prompts à se rallumer. Chez ceux-là on était fasciste, chez ceux-ci républicains. Là ils ont même déterré des bonnes sœurs décédées pour profaner leurs cadavres. Ici, le curé a dénoncé ses ouailles. Fusillées à l’aube dans ce champ. Là, deux frères, l’un était républicain et l’autre de la phalange. La haine est un héritage familial.
Non, la guerre d’Espagne ne fut pas une guerre romantique. Elle n’a pas le visage d’Ernest Hegmigway (Pour qui sonne le glas), ni celui de Malraux (L’Espoir), ni celui de Georges Orwell (Hommage à la Catalogne) ni celui de la fameuse photo remaniée de Robert Capa (La mort d’un républicain) ou encore de Georges Bernanos (Les grands cimetières sous la lune), écrivain qui fut l’un des premiers à dénoncer la répression franquiste et avec lequel Lydie Salvayre établit un contre-chant à sa propre histoire, ou plutôt à celle de sa mère, Monste, dont la mémoire effacée par des troubles irréversibles se résume à l’étincelance d’un été, celui de l’année 36. Cette conflagration brutale qui laissait présager celle à venir sous la botte du nazisme, eut pour acteur et spectateur d’abord et avant tout le peuple espagnol, toutes classes sociales confondues. En préambule, elle fut révolte, puis soulèvement et enfin révolution d’une population éreintée de misère, prise entre l’indifférence hautaine de leurs exploiteurs et maîtres et le goupillon castrateur d’une église catholique arrogante. L’humanité allait triompher. Un autre monde était vraiment possible. Ce fut un beau rêve, un songe où tout parut lumineux et possible, dix secondes d’utopie dans l’éternité du malheur qui habillaient encore d’une incroyable joie mélancolique les yeux des quelques vieux (et vieilles) libertaires espagnols que j’ai rencontrés.
Le temps que les idéologies et ses foutues litanies en isme encrassent les discours, et ce devint l’enfer de la guerre civile. De tous les côtés. Tous fanatiques et meurtriers. Républicains, franquistes, communistes et sans opinion. Suiveurs, suivants et suivis. Seule la puissance des armes détermina le degré d’atrocité dont furent capables les uns et les autres. L’église, si souveraine encore en Espagne, crucifia joyeusement à pleines bénédictions les pauvres, les rebelles, les athées et les suspects en tout genre et Pie XI tendit ses anneaux à baiser au caudillo Francisco Franco.
La jeune et jolie Montse, alors âgée de quinze ans, ne garda de ces tourbillons sanglants que la jubilation libertaire et ses jours radieux où tout arrivait et se vivait. Les rues de Barcelone bruissaient, filles et garçons, on parlait, on riait, on fumait, on se touchait, on buvait, on s’aimait, on croyait aux lendemains chantants. Elle découvrit l’amour et les plaisirs du corps dans les bras d’un jeune français. A peine ébauchée, sa vie s’y termina, lui laissant dans les entrailles, une fille, Lunita, la sœur aînée de la narratrice. Retournée dans son village catalan, grosse de cette promesse honteuse conçue hors mariage qui ne manqua pas d’alimenter les commérages, elle épouse Diego, le rouquin sans charisme, communiste stalinien psychorigide et maniaque, fils mal né de Don Jaime, opposé en tous points au frère de la jeune femme, José. Ce dernier, adolescent charismatique, rouge, anarchiste et libertaire est plein d’illusions. Un môme solaire – qui à mon sens, est dans cette histoire le personnage le plus attachant tant il reste, jusque dans la mort, cohérent avec lui-même – verra ses rêves s’effondrer d’épouvante devant la réalité de la guerre, la mort sommaire et exutoire des uns, les trahisons des autres par intérêt propre ou politique. Lézardes de toute une jeunesse qui allait devenir le cauchemar de la dictature espagnole. Diego et José se haïssent depuis l’enfance, stigmatisant à l’intime comment la guerre greffe les divergences politiques sur les sentiments. José finira par être tué par les phalangistes, peut-être d’une balle tirée par son beau-frère, lors d’un coup de feu sans gloire. En 1939, Montse et sa fille Lunita feront partie de l’interminable file de réfugiés, fuyant le régime franquiste, qui gagneront par le Perthus, la France.
Une histoire belle en elle-même et qui aurait pu préserver son authenticité si le style de Lydie Salvayre n’avait pas flanqué tout ce bel édifice par terre. Le quatrième de couverture nous l’affirme péremptoire. Il s’agit là d’une écriture joyeusement malmenée. On attend de la truculence, de l’humour, de l’inventif, on ne trouve que du ridicule, du lourdingue qui enlise la narration. Un fragnol, sabir de français et d’espagnol qui consiste souvent à simplement franciser grossièrement des termes espagnols, via le langage maternel – burler pour burlar (moquer), griter pour gritar (crier), mirade pour mirada (regard), comprendre pour comprender – ce qui donne par exemple : « Je n’arrivais pas réellement à l’embéléquer – (je suppose pour embellecer) -, si j’ose dire, me dit ma mère. A lui assurer que ses gâteaux étaient les meilleurs de la terre, et à lui faire ces déclarations maravilleuses (maravillosas) que les enfants font à leur mère lorsqu’ils les sentent tristes et en manque d’arrosage.»
Cette truffade d’artificialité finit par être lassante, d’autant plus que Lydie Salvayre, sans doute pour ajouter du piment à une écriture relativement plate, l’épice d’une vulgarité outrancière qui se veut (pour le béotien ignorant de l’Espagne profonde) le reflet fidèle des expressions populaires employées à tout bout de champ par les campesinos. « Me la pongo en el culo… » et ses multiples variantes fricotent avec nombre de cojones, de hombres con o sin huevos, de cabrones, de putas y todos sus hijos, et leurs correspondances en français, couilles, enculé, il se la touche, bite (« ces connes qui veulent à tout prix rester vierges si bien qu’il n’y a pas d’autre moyen que de recourir aux bons offices d’un âne pour se faire sucer la bite. »), etc. Bien que la grossièreté et l’agressivité puissent être concomitants à la maladie d’Alzheimer, Montse, narratrice de sa propre vie, y écorne son portrait et en devient parfois ridicule, voire imbécile.
La vulgarité littéraire lorsqu’elle est employée à bon escient et non pour masquer une pauvreté stylistique peut se révéler réjouissante à l’esprit. Mais ici, elle atteint des cimes de mauvais goût, notamment quand Lydie Salvayre entreprend de disserter, théorie actuelle du genre oblige, sur la musicalité des pets masculins et féminins provoqués par la consommation de pois chiches : « On commence par discuter de… […]…de la différence des pets selon les genres féminin et masculin, tant sur le plan de la musicalité que sur le plan de la fragrance, de leur valeur préventive et curative, et de leur capacité à faire décamper l’ennemi… […]…puis des garbanzos qui le composent (le cocido), pois chiches en français (pourquoi chiches ?), qui sont les plus exquis, les plus délectables, les plus espagnols des légumes de la terre, princes des Fabacées, fournisseurs d’énergie, délicieusement parfumés, connus pour faire bander et qui font péter les hommes bien plus que les femmes, pourquoi ? (plaisanterie typique du mâle espagnol, commente ma mère)…. », ou mesure l’empathie psychique ou physique d’une femme à l’humidité de son vagin : « Mais mon cœur, à cette époque, me dit ma mère, était sec como el chocho de doña Pura excuse l’humour. » – « elle n’avait jamais baisé y su chocho estaba sequito como una nuez. »
Joyeusement malmenée cette prose ? Ou joyeusement massacrée ?
Outre les textes de Bernanos – et heureusement que Bernanos traverse ce livre ! – qui s’introduisent en alternance dans la narration ou encore la liste de tous les signataires, évêques et archevêques, de la lettre épiscopale de juillet 1937 approuvant la dictature de Franco qui n’apporte rien au texte et que la plupart des lecteurs doit zapper, d’autres artifices stylistiques redondants abondent. Employés à petite doses, on peut en apprécier l’usage. Systématiquement répétés, ça gave… mais ça délaye ! Les anaphores pleuvent, adverbes, adjectifs (exemple : immuable), verbes, tout y passe dans cette litanie verbeuse qui non seulement alourdit inutilement le texte mais donne parfois au lecteur l’impression d’être pris pour un abruti. « … le dénigrement furieux de cette République par une Église insolemment puissante, pourvue de banques insolemment puissantes et d’entreprises insolemment puissantes… » ou « Au tumulte joyeux de juillet avait succédé un climat de méfiance qui imprégnait tous les rapports et jusqu’aux plus intimes, quelque chose d’impalpable, quelque chose de mauvais et de délétère qui imprégnait l’air, qui imprégnait les murs, qui imprégnait les champs, qui imprégnait les arbres, qui imprégnait le ciel et toute la terre. » Et encore : « Le manège se répète, identique, tous les dimanches pompompom pompompom, sous les yeux espions de sa mère qui a parfaitement perçu le manège des yeux qui n’est rien d’autre que le manège du coeur pompompom pompompom. » Et la dernière : « Elle se sent paisible. Heureuse et paisible. Elle a le sentiment heureux et paisible de partir en vacances… »
Autre tour de passe-passe pour étoffer cette maltraitance jouissive du récit, la rupture, réitérée elle aussi, de la construction dans les dialogues indirects qui je le suppose, veut coller à l’effervescence décousue de l’oralité. « Du reste, ils disent que le confort américain, ils s’en tamponnent le Mais ce n’est pas du tout ce qu’on leur propose ! s’indigne José… »
Enfin bref, ce rabâchage et cette vulgarité sont indigestes et finissent par brouiller d’agacement la lecture de cet ouvrage, avec ou sans Goncourt, version soupe populaire.
Je ne me souviens plus quand tombe le jour de la fête du livre en Espagne, mais je me souviens du livre que la compagnie de bus qui allait de l’Extremadure à Madrid m’offrit ce jour-là. Un bijou d’écriture, mêlant la pure littérature à la truculence populaire, un livre dont je tairais le titre et l’auteur, tant j’aimerais le traduire. Il parlait de la guerre civile, d’une femme, une paysanne, de ses interminables tribulations à la recherche de la dépouille de son compagnon, des horreurs inscrites dans la terre, des républicains et des franquistes, une sensibilité à fleur d’âme. Un livre de rires et de l’armes.
Au fond, Pas pleurer est un titre excellent… Un titre pour un livre de tête. Et l’on ne peut que donner raison à Georges Bernanos lorsqu’il écrit dans Les grands cimetières sous la lune : Le monde vit d’illusion, c’est-à-dire de prestiges et c’est un grand malheur pour beaucoup que se substitue au prestige des personnes ou même des uniformes, le prestige plus médiocre encore des mots.
© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott -14/11/2014
Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5
du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.
Pas Pleurer, Lydie Salvayre
Editions du Seuil, 2014
ISBN : 978-2021116199
Quatrième de couverture
Deux voix entrelaçées. Celle, révoltée, de Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les nationaux avec la bénédiction de l’Eglise contre « les mauvais pauvres ». Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et « mauvaise pauvre », qui, soixante – quinze ans après les évènements, a tout gommé de sa mémoire, hormis les jours enchantés de l’insurrection libertaire par laquelle s’ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions d’Espagne.
Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement avec notre présent et font apparaître l’art romanesque de Lydie Salvayre dans toute sa force, entre violence et légèreté, entre brutalité et finesse, porté par une prose tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée.
![]()