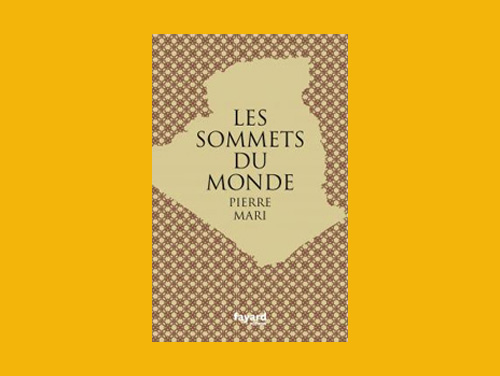L’Histoire ne retient de la réalité de n’importe quelle guerre que des statistiques funèbres, des dates commémoratives, la bâtardise de ses interprétations justificatrices et les polémiques verbeuses, telle celle allumée récemment par les propos opportunément électoralistes d’Emmanuel Macron au sujet de l’Algérie. Qu’on l’admette ou non, toutes les guerres furent et sont colonialistes et elles sont toutes porteuses de crimes contre l’humanité, les génocides étant la manifestation horrifique de leurs extrêmes brutalités. De fait, elles répondent toutes au but inavoué d’instituer par la force au prétexte d’une action civilisatrice, une hégémonie politique, économique, idéologique et/ou religieuse, la culture étant son passe-droit et l’humanitaire, le sauf-conduit paternaliste de sa modernité, du moins de la part de l’Occident. Juste retour de bâton, vient un moment où, selon la formule consacrée, les peuples revendiquent le droit de disposer d’eux-mêmes, droit si fictionnel qu’il se concrétise à son tour par des guerres dites de façon surréaliste d’indépendance. Quelques siècles plus tard, toute honte bue et le remords christique en goguette, on s’excusera de tous ces faux pas dont la responsabilité se perdra dans le collectif. A l’individuel, les femmes, les enfants, les hommes qui ont payé de leur peau cette folie hégémonique, sont jetés dans les fosses communes de l’oubli. Il n’y a guère que les cimetières pour s’en souvenir, les historiens pour exhumer leur mémoire controversée ou les écrivains pour les faire revivre avec plus ou moins de parti pris, l’Histoire étant toujours plurielle.
Alger… La guerre d’Indépendance compte ses morts depuis plus de sept ans. Les haines s’attisent et s’exacerbent. Bombes, explosions, tortures, attentats, enlèvements, assassinats… Tout le monde courtise la mort, les uns pour se libérer du joug du colonisateur français en place depuis 1830 après la chute de l’Empire ottoman, les autres pour rester dans ce pays où leurs ancêtres les ont précédés et où eux-mêmes sont nés, ont grandi et ont fondé à leur tour une famille. Ils se considèrent citoyens de cette terre qu’ils aiment de toutes leurs tripes, bien loin de la Métropole qu’ils regardent comme un ersatz dont ils se méfient, non sans quelque raison. Car les Européens d’Algérie, dont les Français, et les Algériens ne sont que des pions anonymes sur un échiquier politique où les intervenants, De Gaulle, le gouvernement français, l’OAS, le FLN, l’ALN et autres factions, ne ménagent pas leurs coups fourrés et meurtriers pour remporter la partie. Les accords d’Evian du printemps 1962, censés mettre un terme à cette sinistre dramaturgie, n’en paraferont pas cependant la fin.
Les sommets du monde de Pierre Mari n’est pas un livre dont les médias sont friands. Mieux vaut la boucler que de se risquer à en extraire le jus. Le thème en est par trop épineux. Il pourrait se résumer à cette question genre « patate chaude » : pourquoi les Français d’Algérie que l’on n’appelait pas encore les pieds-noirs – des « Français dont personne ne veut » -, sont-ils partis ?
« Il y a la vie qu’on mène et il y a l’autre. Celle qui ne se laissera jamais faire, ni conduire nulle part. Celle qui se fiche bien de toute espèce de chemin, étape ou destination. Celle qui s’accroche à un point de notre histoire, à ne plus vouloir en démordre – continuez sans moi, je plante là ce qui me sert d’étendard, et au diable la suite. On avale tellement de temps qu’on s’en ferait sauter le corps et l’âme s’il n’y avait pas cet acharnement d’orgueil à rester en arrière . A chercher le jour indépassable où tout a été dit. » nous confie Pierre Mari.
Sous sa plume talentueuse où la tendresse parfois acerbe fait la nique à l’ironie et souvent à une colère contrôlée, l’auteur entrecroise deux récits parallèles intimement liés autour de la même thématique : celui du passage de la fin d’une époque à une autre. D’une part, la fin de l’Algérie française et la naissance brutale de son autonomie et d’autre part, le passage à l’âge adulte d’un jeune homme plutôt insouciant qui découvre l’insanité du monde dans le miroir des évènements et des contradictions de ses propres sentiments à l’égard d’abord de sa bande de copains et de ses parents incrustés dans l’imagerie confortable et insipide de père et de mère, et ensuite de Marie, jeune femme maternelle et protectrice, de Colette, fille de bonne famille qu’il croit aimer mais dont il n’est pas amoureux et d’Agnès son premier amour évidemment sublimé.
Dans « cette vie qu’on mène », chaque dimanche, accompagné par Michel l’intellectuel, ou par Jéronimo « fine mouche, arracheur de masques comme personne » ou encore Robert, ancien des Corps Francs et frère aîné du narrateur, mais plus souvent en compagnie du narrateur lui-même, Marcel, le fils autiste de Mme Zaragoza, va se balader sur les hauteurs d’Alger, cette « ville vouée au ciel ». Il incarne l’indolence de cette Algérie dont les Français, mais aussi les Italiens, les Espagnols et les Maltais, apprécient la douceur de vivre, la main sur le cœur et le cœur sur la main, malgré la difficulté d’une vie plutôt chiche. La plupart sont de petites gens, ouvriers, commerçants, fonctionnaires, et n’ont rien de l’archétype minoritaire du sale colonialiste, nabab esclavagiste et tortionnaire. Certes, dans leur grande majorité, ils sont imprégnés de cet esprit colonialiste qui nourrit insidieusement le mépris de l’autre, l’Algérien, l’Arabe, dont ils ne comprennent pas ou mal la façon de vivre. Ils se côtoient, se supportent, mais ne se mélangent pas. Leur racisme, qui néanmoins n’est pas loin s’en faut une spécificité occidentale, est banal. Il a son vocabulaire : « bicot, raton, melon, troncs de figuier, pinsons, merles« , tout comme les Arabes ont le leur pour les Roumis. Leur entente est un face à face armé.
Dans le brouhaha des rues d’Alger, Pierre Mari nous entraîne dans le quotidien de cette communauté blanche. Elle ne connait souvent de l’Algérie que la ville où elle habite, ne parle pas arabe et en méconnait la culture, et sans être ouvertement contre les Algériens, elle n’est pas franchement pour eux non plus. Pour la plupart, les luttes intestines sont verbales plus qu’activistes. Chacun a son mot à dire. La peur grandissante des uns devant les massacres et les exactions commises autant par le FLN, l’ALN, l’OAS, l’armée française et les différentes forces pro et anti-coloniales, répond à la haine farouche des autres ou encore à ceux qui ferment les yeux pour ne pas à avoir à choisir leur camp. Les arguments volent de balcon en balcon, les drapeaux français aussi. Partir, rester ? Rester, partir ? A quel prix ? Pourquoi ? Comment ? Il y a la rage de devoir abandonner tout ce pour quoi des générations d’Européens ont œuvré. « Vous imaginez si on s’en va ? Vous le voyez le tableau ? Qui c’est qui conduit les locomotives, qui fait marcher les hôpitaux ? Et la terre, qui c’est qui va la travailler, qui c’est qui installe l’électricité dans les villages? Qui c’est qui fait respecter la loi ? On s’en va et c’est feu et sang le lendemain…[…]… Bouffez de l’indépendance algérienne, faites-vous pétez la sous-ventrière avec votre Algérie algérienne – moi je mets ma main au feu qu’au bout d’un mois vous envoyez une bande de Ben Couscous et de Ben Méchoui à Paris, des salamalecs à n’en plus finir, qu’on revienne vous donner la soupe à la cuillère ! » s’emporte Jo Vivaldo, père de Colette et conducteur de locomotives, exprimant une opinion quasi générale, faisant écho à la sagacité désenchantée du Capitaine Castaing. : « à cette allure, c’est facile à deviner, ce qui va arriver. Pas besoin d’être malin. Le bel Occident, l’Occident généreux, il va aller de victoire morale en victoire spirituelle, et y laisser chaque fois un bout de peau. Et puis, après les bouts de peau, un doigt, un orteil, et même un œil ou une jambe – on peut s’en passer, d’un œil ou d’une jambe, hein, tant qu’on a l’âme, la noblesse, la culture et tout le tintouin ! Et à la fin, il en restera quoi du bel Occident ? Zhouba, comme dirait le père Vivaldo. » Et sans doute également, ce sentiment inavoué d’avoir à céder leur place, du moins à la partager, avec ceux-là même qu’ils tiennent si peu en considération, les Arabes.
Dans l’autre vie, « celle qui s’accroche à un point de notre histoire, à ne plus vouloir en démordre », il y a le 13 mai 1958, le putsch d’Alger, où « quelque chose s’est affranchi de la saleté sanglante qui éclaboussait le pays depuis des années. Quelque chose a ressemblé au salut à s’y méprendre. On y a tous cru, sans exception… […]… On a vu les Arabes hésiter – certains pétrifiés d’embarras, d’autres pas chauds à l’idée d’entrer dans une fiesta qui s’était allègrement passée d’eux jusqu’à présent. Je ne sais pas d’où ni comment il est venu l’appel à se confondre. Mais tout ce qui traînait encore de chiens de faïence a été écarté, balayé, expulsé d’un coup. Les poitrines se sont jetées les unes contre les autres. On pleurait, on s’étreignait, on se bénissait en riant….[…]… J’avais les mains levées – l’une nouée à celle d’un jeune Arabe en costume sombre, l’autre que serrait à trembler un type tout raviné, en uniforme de receveur de tram… » Une Algérie française ou fédérale prônent certains : « Autour de nous, ça refaisait ferme l’Algérie : les idées fusaient, on s’empoignait allègrement, on reconnaissait qu’il y avait du grain à moudre, de la besogne à abattre – la politique ne serait plus la mise en musique des trouilles et des lâchetés d’en haut, et d’ailleurs, le mot de politique, on n’en voulait plus, il en faudrait un neuf, décrassé, pour coller au plus près à la merveille d’aujourd’hui. » Las ! Après l’ivresse, la gueule de bois. Le narrateur dont la lucidité lui murmure que ce qui devra être sera, regarde l’Histoire dérouler son pitch meurtrier avec une désillusion sereine. « Peut-être qu’au fond tout le monde était comme moi. Chacun à s’avouer, for intérieur bien verrouillé, que c’était foutu irrémédiablement – et à beugler dans la rue un espoir qui ne tenait pas debout. Y croire, ne plus y croire, dans des moments pareil, allez démêler la pelote...[…]… Au plus fort de l’enthousiasme, je me suis quand même dit, balancier oblige, que la gueule de bois aurait son heure...[…]... Seulement voilà, quand on est monté si haut, poumons comblés, crêtes et horizons plein la vue, on est prêt à toutes les contorsions pour ne pas dévisser. » Les affrontements entre indépendantistes, partisans d’une Algérie française, l’armée française, elle-même en proie à de nombreux conflits intérieurs, se soldent par des carnages de plus en plus fréquents jusqu’à celui de la rue d’Isly, le 26 mas 1962, où des militaires, des gendarmes et des CRS tirent sur tout ce qui respire, enfants et nourrissons inclus, tandis que des avions français bombardent Bab-El-Oued. Des Français bousillent sur ordre d’autres Français, dont le seul tort est de refuser ce que l’on veut leur imposer. Le narrateur y perdra son frère, Robert.
Pour beaucoup de Français d’Algérie, cet événement précipitera leur exode sans joie vers la Métropole. La perte de confiance est irrémédiable. Abandonnés et trahis, beaucoup pratiqueront la politique de la terre brûlée et De Gaulle en prendra pour son grade : « homme providentiel de l’Algérie française – et pourquoi pas pendant qu’on y était, le renard bombardé sauveteur en chef du poulailler...[…]… Vous rêvez ou quoi ? Pour la grande asperge, l’Algérie, c’est un million de pétainistes et neuf millions de bougnoules. Il a la rancune infernale ce type. Vous croyez qu’il va vous mitonner une bonne petite Algérie Française ? Moi, je vous dis, à la première occasion, il dégage. Et vous aurez beau chialer toutes vos larmes, lui, il s’en tamponnera le coquillard. Vous verrez, vous allez apprendre ce que c’est, la politique. C’est de la merde, du sang et de la fouterie de gueule. Il va vous faire baver des ronds de chapeau , le vieux. Et vous allez vous en rappeler toute votre vie. »
Les sommets du monde ont de quoi défriser l’intelligentsia du politiquement correct. Il ne fait jamais bon d’en secouer les tapis miteux.
La dernière partie de l’ouvrage soulève une autre question : que peut-on faire avec l’amour du pays natal qui vous a vu naître et grandir lorsque l’Histoire décide de vous en expulser ? Que peut-on faire de la douleur de l’exil lorsqu’elle vous colle irrémédiablement au cœur, maquille votre mémoire de souvenirs et vous aveugle de nostalgie ? Le problème avec l’exilé est qu’il regarde sans cesse en arrière plutôt que de jouir de ce qui s’offre à lui, devant lui, et d’en repousser les limites. Bien peu malheureusement y parviennent, le pays d’accueil étant lui-même perçu comme une terre d’exil, une errance sans fin.
Au terme de cet ouvrage passionnant, une interrogation demeure néanmoins en suspens. Pourquoi ne parle-t-on jamais, ou très rarement, des quelques 200 000 Français qui en 1963 ont refusé la valise ou le cercueil ? La peur a peut-être aussi son racisme.
Non sans raison, Rilke a écrit : « Nous naissons pour ainsi dire provisoirement quelque part. C’est peu à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine, pour y naître après-coup et chaque jour plus définitivement.»
© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott –28/01/ 2017
Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5
du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.
Notes
Lire à ce sujet
Pierre Daum,Ni valise ni cercueil, 2012, éditions Actes Sud.
Anne Loesch, La valise et le cercueil, 1963, Plon.
Quatrième de couverture
À Alger, en 1961, tout prenait le goût étrange des dernières fois. Dernières promenades sur les hauteurs de la ville, entre ciel et mer, dernières conversations animées dans la chaleur d’un appartement exigu, derniers tourments amoureux baladés entre les murs blancs des ruelles. Rien n’était décidé, rien n’était officiel, et pourtant tout le monde le savait : tôt ou tard il faudrait partir. Du célèbre discours de Mostaganem au blocus de Bab El Oued, une poignée d’amis vit les dernières heures de l’Algérie française. Acharnés pour certains, fatalistes pour d’autres, ils encaissent vaille que vaille les coups de l’histoire, se sachant trop petits, trop humbles pour en infléchir le cours. Et qu’il se transforme en haine, en colère ou en nostalgie, c’est le désarroi qui les soude : celui de se sentir inexorablement relégués au rang d’encombrants, d’incarner ce que l’avenir jugera bientôt dépassé.
Pierre Mari est romancier et essayiste. On lui doit notamment Kleist, un jour d’orgueil (PUF, 2003) et Les Grands Jours (Fayard, 2013)
![]()