 Au moment de commencer cette lettre, je me rends compte que je ne sais comment vous appeler, Yasmina ou Mohamed ?
Au moment de commencer cette lettre, je me rends compte que je ne sais comment vous appeler, Yasmina ou Mohamed ?
Nous nous sommes rencontrés un soir, une des ces nuits où mon silence s’ouvrait à vos confidences. L’aube me trouva avec le mot fin signant votre autobiographie. Je venais de lire L’Ecrivain. Écrivant moi-même quoique sans notoriété aucune, le titre m’avait attirée autant par mimétisme que par curiosité. Néanmoins, j’avais quelque méfiance à l’orée de vos aveux. Tellement d’auteurs, plus plumitifs qu’écrivains, s’attribuent si facilement un génie surnaturel et involontaire qu’ils subissent extatiquement plutôt que de reconnaître modestement le fruit d’un talent besogneux empreint de doutes ! Au moment d’être honnête, beaucoup s’inventent des vies édulcorées ou plongent dans un mal être insubmersible qu’ils vivent comme une malédiction personnelle ou sociale et exsudent comme une intimité fascinante, ponctuée d’indélébiles traumatismes. Mais, que voulez-vous, j’éprouve une sympathie immédiate pour les êtres qui s’impliquent et se risquent à partager à l’exacte mesure de ce qu’ils sont, que ce soit un bon saucisson mouillé d’excellent vin ou une mémoire qui s’égrène avec la discrétion d’un tasbich. Et j’ai aimé cet homme tourmenté, à l’identité indéfinie, qui dévoilait au détour de son enfance défaite et reconstruite à la badine militaire ce qui l’avait intimement structuré, ce sentiment d’abandon imprégné de ressentiment revanchard, le convertissant en un éternel exilé de lui-même et des autres, moche et complexé, et le patinant d’une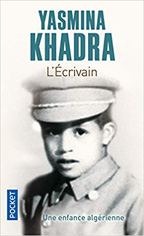 nécessité dévorante d’être reconnu plutôt qu’aimé. Écrire donc pour rejoindre plutôt que s’unir à cette humanité intime qui l’avait nié. Ce Mohamed là avait quelque chose du Momo d’Emile Ajar qui affirmait : Je pense que pour vivre, il faut s’y prendre très jeune, parce qu’après on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de cadeaux…
nécessité dévorante d’être reconnu plutôt qu’aimé. Écrire donc pour rejoindre plutôt que s’unir à cette humanité intime qui l’avait nié. Ce Mohamed là avait quelque chose du Momo d’Emile Ajar qui affirmait : Je pense que pour vivre, il faut s’y prendre très jeune, parce qu’après on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de cadeaux…
Je me suis donc attelée à la lecture chronologique de vos livres avec gourmandise et prudence, d’autant plus que vous avez la réputation d’être rétif à la moindre critique et d’accuser promptement vos détracteurs de ne pas les avoir lus. N’ayant pas trouvé vos premiers écrits, ceux où vous signiez Mohamed Moulessehoul, j’ai commencé par ceux où sous les traits du commissaire Brahim Llob, vous vous dissimuliez sous ceux d’une femme, répondant au nom harmonieux de Yasmina Khadra, le jasmin vert.
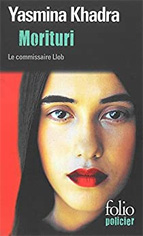 Il faut vous avouer qu’à lire Morituri (1997), Double blanc (1997) et l’Automne des chimères (1998), je me suis fait la réflexion qu’il fallait être aveugle, sans doute par attachement dogmatique à cette consonance féminine de votre pseudonyme littéraire, pour avoir été convaincu a priori et sans étonnement, et ils furent nombreux, que les enquêtes de votre commissaire à la lucidité décapante et désabusée avaient été écrites par une femme.
Il faut vous avouer qu’à lire Morituri (1997), Double blanc (1997) et l’Automne des chimères (1998), je me suis fait la réflexion qu’il fallait être aveugle, sans doute par attachement dogmatique à cette consonance féminine de votre pseudonyme littéraire, pour avoir été convaincu a priori et sans étonnement, et ils furent nombreux, que les enquêtes de votre commissaire à la lucidité décapante et désabusée avaient été écrites par une femme.
A la lecture de cette trilogie, je n’ai pu m’empêcher de songer que le choix de ce pseudo féminin dont vous avez pleinement assumé la paternité lors de votre coming out littéraire en 2001, répondait à des motifs tout en nuances, bien que les médias les aient souvent réduits à leur plus simple expression. Le premier, le plus évident, fut inhérent à votre statut d’officier. En Algérie comme ailleurs, être militaire de carrière ou non relève toujours du secret défense. On obéit aux ordres et d’accord ou pas, on ferme sa gueule sous peine de sanctions disciplinaires, entre mutations intempestives, mise sur voie de garage pour le meilleur ou envoi au casse-pipe ou au pilori pour le pire. Le second, vous le dites vous-même, fut un hommage amoureux à votre compagne, quoique dans votre intimité je l’imagine mal vous appeler par son propre prénom ! De toute façon, dans tout ce fatras, il y a eu un foutage de gueule certain. Car je doute fort que vous l’ayez choisi aussi innocemment que vous voulez bien l’admettre. Dans un monde, qu’il soit d’Orient ou d’Occident, où la femme n’a pas plus de valeur qu’une bête de somme et de plaisir, il faut avoir des couilles et un esprit avéré de la provocation pour adopter un pseudonyme féminin. N’affirmez- vous pas dans L’automne des chimères que c’est pour rendre hommage au courage de la femme. Parce que, s’il y a bien une personne à les avoir en bronze, dans notre pays, c’est bien elle ! Permettez-moi d’ajouter dans tous les pays ! A l’inverse de vous, j’ai songé un instant, avant d’y renoncer tout aussi rapidement, à recourir à un pseudonyme masculin comme signature métaphorique et sésame littéraire. Ne souriez pas ! C’eut été me concéder une lâcheté facile pour finir peut-être par appartenir à un sérail de coqs, fort peu éloigné de cette cacophonie toute féminine que notre langue française prête au poulailler.
vous pas dans L’automne des chimères que c’est pour rendre hommage au courage de la femme. Parce que, s’il y a bien une personne à les avoir en bronze, dans notre pays, c’est bien elle ! Permettez-moi d’ajouter dans tous les pays ! A l’inverse de vous, j’ai songé un instant, avant d’y renoncer tout aussi rapidement, à recourir à un pseudonyme masculin comme signature métaphorique et sésame littéraire. Ne souriez pas ! C’eut été me concéder une lâcheté facile pour finir peut-être par appartenir à un sérail de coqs, fort peu éloigné de cette cacophonie toute féminine que notre langue française prête au poulailler.
Je pense que votre choix fut dicté également par cette autre évidence hypocritement passée sous silence : se faire éditer en France en s’appelant Mohamed, ce n’est pas gagné ! Je doute fort également que les services secrets algériens – d’autant plus que pour avoir bourlingué dans des pays où la corruption et les ambitions personnelles font et défont l’économie, je sais qu’il suffit de graisser la patte, plus ou moins lestement, à la personne opportune pour obtenir l’information pertinente – aient ignoré que Yasmina n’était que le travesti de Mohamed. Que le sérail intellectuel parisianiste vous ai fait de féroces procès d’intention, vous soupçonnant de toutes les traîtrises opportunistes, ne m’a guère étonnée non plus, d’autant plus qu’il est facile de stigmatiser et de moraliser les horreurs de la guerre, de toutes les guerres, quand on a le cul bien au chaud. La colère du commandant Mousselhoud fut parfaitement légitime, d’autant plus que l’actualité continue à abonder dans son sens et que notre silence collaborationniste est toujours aussi bruyant. Que savez-vous de la guerre, a-t-il écrit dans sa lettre de démission, vous qui êtes si bien dans vos tours d’ivoire, et qu’avez-vous fait pour nous qui tous les jours, enterrions nos morts et veillions au grain toutes les nuits convaincus que personne ne viendrait compatir à notre douleur ? Rien… Vous n’avez rien fait… Huit années durant, vous avez assisté à une intenable boucherie en spectateurs éblouis, ne tendant la main que pour cueillir nos cris ou nous repousser dans la tourmente à laquelle nous tentions d’échapper.1
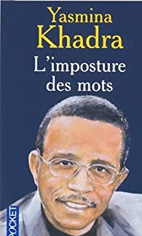 Cependant, Zarathoustra a eu bigrement raison de vous remettre rudement à votre place dans L’imposture des mots, en déminant cet état dépressif qui vous submerge sournoisement dès lors que vous n’obtenez pas le succès que vous pensez mériter : elles s’arrêtent où tes limites ? Depuis que tu as débarqué en France, tu n’arrêtes pas de nous les ébranler avec ton martyr. Mais d’où c’que tu sors, bonhomme ? T’es au troisième millénaire. La haute bohème, c’est fini. Sartre, Dante, Goethe, Malraux, ça fait un bail qu’on se rappelle plus quelle marque de bagnole c’est. Sabre-toi la queue et tâche de ne pas te prendre les pattes dans ton tricot. Les idoles, aujourd’hui, arborent un début de barbe horrible, se sapent débraillé et rotent comme des cochons sur les plateaux de télé. La mode n’est plus à la correction, encore moins à la cuistrerie. Pour être adoré, une formule bien banale : être un sacré veinard, avec une réflexion approximative, sinon carrément vache, et une gueule bien faite pour sauver la mise. Faut surtout pas causer talent. Ce serait une atteinte à ces néodivinités qui ont investi l’Olympe en prouvant tous les jours que le Bon Dieu défait, que le génie a changé de résidence, qu’il est dans la poche et plus dans la tronche.2
Cependant, Zarathoustra a eu bigrement raison de vous remettre rudement à votre place dans L’imposture des mots, en déminant cet état dépressif qui vous submerge sournoisement dès lors que vous n’obtenez pas le succès que vous pensez mériter : elles s’arrêtent où tes limites ? Depuis que tu as débarqué en France, tu n’arrêtes pas de nous les ébranler avec ton martyr. Mais d’où c’que tu sors, bonhomme ? T’es au troisième millénaire. La haute bohème, c’est fini. Sartre, Dante, Goethe, Malraux, ça fait un bail qu’on se rappelle plus quelle marque de bagnole c’est. Sabre-toi la queue et tâche de ne pas te prendre les pattes dans ton tricot. Les idoles, aujourd’hui, arborent un début de barbe horrible, se sapent débraillé et rotent comme des cochons sur les plateaux de télé. La mode n’est plus à la correction, encore moins à la cuistrerie. Pour être adoré, une formule bien banale : être un sacré veinard, avec une réflexion approximative, sinon carrément vache, et une gueule bien faite pour sauver la mise. Faut surtout pas causer talent. Ce serait une atteinte à ces néodivinités qui ont investi l’Olympe en prouvant tous les jours que le Bon Dieu défait, que le génie a changé de résidence, qu’il est dans la poche et plus dans la tronche.2
A terminer donc la lecture de cette trilogie policière, ma première impression fut d’abord un franc agacement. Là où beaucoup s’extasiaient sur la verdeur de langage, le foisonnement poétique, la métaphore surprenante ou la tournure acérée d’une supposée plume féminine, je ne vis qu’une tentative confuse et pathétique pour atteindre une excellence imaginée de la langue française, ainsi qu’un excès de vulgarité qui s’apparentait plus au paraître qu’à l’être, un peu comme ces cuisiniers portées aux nues de la gastronomie qui vous mettent trois crottes dans une assiette et les élèvent au rang chèrement facturé de chef d’œuvre de l’art gustatif, alors qu’une femme, tout aussi talentueuse cuisinière, saura mêler la subtilité du goût à la quantité de matière. Ce trop « c’est trop » qui pourrissait plus vos descriptions hasardeuses et monolithiques, un de vos gros défauts stylistiques, que vos dialogues finement structurés tant dans le contenu que le contenant, m’a mis l’esprit aux aguets. Votre pseudo féminin n’avait d’autre consistance que celle de sa supercherie…
Votre professeur de français, un certain Kouadri, vous avait pourtant prévenu de la perversion de cette exubérance calculée. Cher monsieur Moulessehoul, vous sermonnait-il, si ton phrasage était aussi crédible que ton rafistolage, ton talent ferait ravage au cercle des dormants. Mais, vois-tu, la littérature a horreur du bricolage et ce n’est pas en chipant par-là une phrase de maître et en empruntant par-ci un mot à M. Larousse que l’on devient Kateb Yacine… Il te soupçonnait de butiner dans les livres de quoi féconder tes textes.3 Du temps de votre enfermement militaire, votre jeune ami Ghalmi vous avait également mis en garde : tu crois ton français châtié alors qu’il est pindarique (ampoulé, emphatique) et creux. Tu deviens farfelu en voulant être savant ; c’est une grosse maladresse… […]… La grandiloquence, c’est le faste des carnavaliers.4 Dans la bouche d’un môme, pindarique perd toute crédibilité ! Votre style, même si je reconnais que l’expérience acquise l’épure et l’affine de plus en plus, y gagnerait encore à se défaire de ses formulations pompeuses, de ses diarrhées d’adjectifs, de ses mots dont vous devez être l’un des rares à jouir du sens, comme gueuser (mendier) ou immarcescible (qui ne peut se flétrir, vous qualifiez ainsi par exemple… l’herbe !) ou encore déréliction (sentiment d’abandon, de solitude), sans parler de cette grossesse nerveuse dont vos personnages, vous-même et même le soleil sont régulièrement victimes, sans oublier le jargon militaire que vous arrivez toujours à nous refourguer d’un livre à l’autre ou encore ses descriptions faussement poétiques qui s’envolent en volutes lyriques un tantinet ridicules, comme celles-ci : l’horizon accouche à la césarienne d’un jour qui…5 ou le soleil voudrait bien flirter avec les nuages mais il craint d’être pris pour un canard sauvage6, ou les branches hystériques des arbres7 ou son rire de théière oubliée sur le brasero,8 ou encore ces bulldozers hunniques qui, je ne me rappelle plus dans quel texte, m’ont plongée dans la perplexité. Je m’imaginais bien les Huns et leurs redoutables conquêtes, mais de là à assimiler leurs prouesses belliqueuses aux bulldozers…
La forme peut rendre indigeste le fond et prêter à l’ensemble une certaine schizophrénie. La disharmonie textuelle est d’autant plus flagrante que les conversations de vos personnages empruntent souvent une teneur moins dithyrambique, laissant affleurer finement une réalité éminemment crue et vraie, de celle qui dérange et que l’on déteste entendre, et dont vous en faites une excellente analyse. Brahim Llod a donc failli mettre fin, pour moi, à la carrière de Yasmina Khadra. Mais la vie s’est chargée de m’apprendre, tout comme à vous je le suppose, que les jugements à l’emporte-pièce sont les œillères des pires dogmatismes. Confiante en votre passion des mots et en l’amour que vous portez à votre pays, je vous ai donc laissé me guider dans cette Algérie dantesque et glauque, miroir ponctuel de toutes les horreurs dont l’Homme a été, est et sera toujours capable à la solde des circonstances, des idéologies et des magouilles financières – qu’elles soient le fait des individus ou de l’appétit gargantuesque et cynique des hautes sphères – qui forgent soit sa commune lâcheté et sa férocité impavide soit ses refus et son courage, ceux-là beaucoup plus rares.
Cette trilogie que l’on dit appartenir au monde du polar pour sans doute amoindrir sa dérangeante véracité historique aux multiples intrications collectives et individuelles et aux non moins pléthoriques implications politiques, religieuses, financières, mafieuses, m’a semblé ne poser que les prémices du terrorisme islamiste dont vous décrivez la mortifère ascension, d’abord en terre algérienne, dans des Anneaux du Seigneur (1998) et dans A quoi rêvent les loups (1999), ensuite en terre afghane dans Les hirondelles de Kaboul (2002), puis en terre israélo-palestinienne dans L’Attentat (2005) et enfin, en terre irakienne dans les Sirènes de Bagdad (2006).
Cependant, d’Alger à Ghachimat, de Kaboul à Bagdad en passant par Tel Aviv via la Palestine, le scénario reste le même. Les hommes s’enrôlent dans ce qui se présente afin d’échapper à la monotonie peu virilisante de leur ennui quotidien ou se font saigner comme porcs à l’abattoir, les femmes se font violer, avant de se faire assassiner au nom du repos des guerriers, les enfants n’échappent pas au jeu de massacre, les maffieux de tout poil font leur beurre, les politiciens et financiers qu’ils soient ou non du bon côté du manche, qu’ils soient blancs ou non, qu’ils soient véreux ou non, engrangent l’oseille et ouvrent des nouveaux marchés, les intellectuels dépriment et se taisent, les intégristes islamistes font régner la terreur, assoient leur pouvoir sur un prosélytisme sanguinaire, avant de se bouffer entre eux pour jouir de son exclusivité très temporelle. Un peu partout, les bombes explosent au nom de Dieu, qui ramassant à la petite cuillère des lambeaux de chair humaine, se fout éperdument de reconnaître les siens et le peuple compte les coups pour savoir quand, où et comment retourner sa veste, à l’image de Zane le nain9, qui fait payer à tout son village, sa cruauté gratuite à son égard.
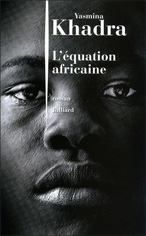
L’état des lieux que vous dressez de notre planète, aussi littéraire et talentueux soit-il, est consternant de continuité, car inhérent à tous les temps de l’humanité. Ghachimat aurait pu être un village français ou espagnol, albanais ou serbe, libanais ou libyen, somalien ou syrien quand la victoire des uns vient régler des comptes à la défaite des autres. Le plus terrible – que vous explicitez fort bien – est que les hommes s’oublient par lâcheté et tuent presque par désœuvrement, avant que d’y prendre goût. Dans A quoi rêvent les loups ?, Nafa Walid, le citadin, n’a rien à faire et ne sait pas, en outre, quoi faire : claquer la porte ? Pour aller où ? Retourner à Bab El-Oued renifler les caniveaux défoncés, errer à longueur de journée à travers les ruelles retorses de la Casbah… […]… pour finalement, rentrer bouder l’existence insipide au fond d’une chambre aux volets clos ?10 Il n’a rien à envier à Kada Hilal, le campagnard, qui crève d’ennui dans son bled : au début, on se fabrique une tête de mule, des œillères et on fonce. On n’a qu’une seule idée fixe : foutre le camp. Mais on retourne à la case départ. Et là, c’est trop tard pour rectifier le tir…11 Dans Les Sirènes de Bagdad, le héros non violent par nature, verra sa vie basculer non à cause des exactions de l’armée américaine, sinon parce que l’honneur due à son clan s’est écroulé avec la vision des parties génitales de son vieux père, brutalisé par les soldats. Tous trois finiront par se convertir en fous de Dieu. Il suffit souvent d’une étincelle pour mettre le feu à nos poudres assassines et en attiser les incendies. Et le terrorisme islamiste n’est qu’un instrument de ce dévoilement des êtres dans ce qu’ils ont de plus sombre.
Du nord au sud, de l’est à l’ouest, même un pétard mouillé peut provoquer un tel embrasement…
Une promotion sur un podium directorial refusée et Jessica, jeune femme en apparence comblée par la vie et élevée au rang d’icône parfaite par l’adulation égoïste et fantasmée de son époux, se suicide précipitant son brillant médecin de mari dans une Equation Africaine dont malgré son intelligence et sa culture et à cause d’une vie douillette qui efface facilement de ses ardoises les malheurs du monde, il ne soupçonnait même pas les inconnues et la résolution. Capturé par des pirates dont certains, je vous avoue ma surprise, parlent comme des énarques, en compagnie d’un humanitaire friqué dont la lucidité s’arrête aux limites des conventions bobos, le voici découvrant une Afrique où les otages se vendent comme des monnaies de singe aux enchères du marché et des intermédiaires jusqu’à parvenir au dernier commissaire priseur, celui qui négocie avec les gouvernements occidentaux. J’éviterais de relever la romance amoureuse qui sous tend ce récit, celle-ci ne me paraissant qu’une douceur facile pour nous faire digérer l’amertume de cette pilule africaine.
Dans L’Attentat, une jeune femme, Sihem, joue les kamikazes et emporte avec elle dix-sept personnes qu’elle ne connaissait pas. Son mari, le docteur Amine Jaafari, chirurgien israélien d’origine arabe qui a misé sur une intégration sans bavures, découvre alors qu’il vivait avec quelqu’un dont il ignorait l’essentiel. Elle était sa femme et cela lui suffisait. Le voilà qui se trouve confronté à la tragédie palestinienne, quasi un épiphénomène pour lui, tant son égoïsme prime : on ne fausse pas compagnie comme ça à son mari. En tous les cas, pas à moi. Je n’ai jamais fauté vis-à-vis d’elle. Et c’est ma vie qu’elle vient de foutre en l’air.12 Il veut comprendre, il veut savoir pourquoi elle lui a fait cela. De Bethléem à Janin, il fonce tête en colère contre des portes qui s’ouvrent difficilement, mettant en danger la vie d’obscurs résistants de cette Intifada, passée dans les mœurs informatives comme une vulgaire habitude et découvrira que s’il n’a que des opinions, d’autres, dont sa compagne, ont des convictions.
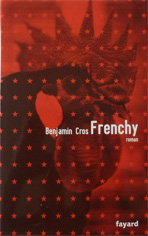 Devant cette thématique récurrente, je vous ai soupçonné d’avoir choisi de faire de tous les conflits belliqueux de notre pathétique évolution actuelle, votre fonds de commerce littéraire, d’autant plus que vous avez commis sous le nom de Benjamin Cros, un roman opportuniste et fort mauvais Frenchy (2004). Coupable différé et victime désignée de la dissidence chiraquienne refusant de s’acoquiner au mensonge messianique de Bush dont l’intérêt principal ne fut pas de virer d’Irak son ex-pote Saddam Hussein, un français, surnommé Frenchy, et son épouse sont obligés d’en découdre malgré eux avec de miséreuses cervelles texanes aux gros bras tatoués jusqu’à la racine des cheveux, élevant la haine de l’Américain moyen envers le Français, ignoblement ingrat en regard de tous les soldats US tombé sur les champs d’honneur normands, au rang de règlement de compte villageois intra-communautaire teigneux. Je ne sais quelle raison vous a motivé à endosser ce pseudonyme, mais la patte de Yasmina Khadra s’y est perdue, faisant de cet ouvrage mal écrit et sans âme, une caricature primaire et bourrée de poncifs de cette Amérique que l’on dit profonde, quand on la stigmatise primitive. Le roman y aurait certainement gagné à s’en tenir à la nouvelle.
Devant cette thématique récurrente, je vous ai soupçonné d’avoir choisi de faire de tous les conflits belliqueux de notre pathétique évolution actuelle, votre fonds de commerce littéraire, d’autant plus que vous avez commis sous le nom de Benjamin Cros, un roman opportuniste et fort mauvais Frenchy (2004). Coupable différé et victime désignée de la dissidence chiraquienne refusant de s’acoquiner au mensonge messianique de Bush dont l’intérêt principal ne fut pas de virer d’Irak son ex-pote Saddam Hussein, un français, surnommé Frenchy, et son épouse sont obligés d’en découdre malgré eux avec de miséreuses cervelles texanes aux gros bras tatoués jusqu’à la racine des cheveux, élevant la haine de l’Américain moyen envers le Français, ignoblement ingrat en regard de tous les soldats US tombé sur les champs d’honneur normands, au rang de règlement de compte villageois intra-communautaire teigneux. Je ne sais quelle raison vous a motivé à endosser ce pseudonyme, mais la patte de Yasmina Khadra s’y est perdue, faisant de cet ouvrage mal écrit et sans âme, une caricature primaire et bourrée de poncifs de cette Amérique que l’on dit profonde, quand on la stigmatise primitive. Le roman y aurait certainement gagné à s’en tenir à la nouvelle.
Je le reconnais, cette emprise de l’actualité sur vos romans, a fini par m’irriter. Ma réaction fut sans doute d’ordre épidermique. Certains critiques vous ayant comparé à un Musso algérien inversé, je voyais quelque facilité à faire de l’islamisme intégriste et des conséquences du djihadisme, votre thème unique, à l’instar de ces têtes de gondole qui érigent en fonds de commerce réitératif l’amour guimauve et l’éveil de conscience, rédempteur supposé de toutes nos déviations passées et présentes. Néanmoins, force est d’admettre qu’à revisiter ces évènements, vous nous en offrez une narration empreinte de réalité sans échappatoire possible. Au check point, perdu entre le nulle part et l’ailleurs du désert irakien, on devient partie prenante de ces instants qui font basculer la vie dans le cauchemar. Les soldats américains bardés de balles, de trouille et d’excitation, Souleyman, le fou du village Kafr Karam, sa fuite éperdue et son cri insoutenable tandis que son dos est transformé en passoire avant qu’un sniper lui fasse exploser le crâne, son père, humble ferronnier, et le narrateur, un jeune bédouin, tous deux anéantis par une incompréhension hallucinatoire ou encore le mariage enterré net par un missile13, tout cela fait lever de nos archives mémorielles du 20H des scènes et des visages qui désormais auront un nom, même si malheureusement cette sauvagerie propre et son iniquité éthique ne font pas tomber nos charentaises de nos pieds. Dans ce sens, vos livres que l’on ne peut qualifier de romans, sont dans la belle lignée de ceux écrits par les aristocrates du reportage, tels Kessel, Londres ou Helsey.
 Vous vous définissez comme un homme de paix, de réconciliation et un humaniste au sens philosophique du terme. Soit. Mais votre monde, ou du moins le monde de Yasmina Khadra, est peuplé de méchants, de brutes épaisses et sanguinaires dont l’envergure mentale a le diamètre d’un petit pois ou de cerveaux bedonnants, embagousés jusqu’aux dents, fumant d’énormes cigares, avachis dans de luxueuses villas copiant le style hollywoodien de cet américanisme qu’ils envient et fustigent et dont ils souhaitent l’anéantissement, tout en recomptant sur leurs doigts boudinés les retours en bénéfices de leurs investissements sur le massacre des peuples dont ils se foutent de savoir quelle est leur religion ou la couleur de leur peau. Dans ce no man’s land du cynisme, se croisent sans se comprendre, en couches étanches et cloisonnées, des ados déboussolés, travaillés par la frustration du sexe et la folie consumériste des grandeurs, des gens ordinaires, puant la déprime et la rancune, moches, crétins, aigris, complexés, paumés, déchards (personnes vivant dans la misère), des petites frappes et des assassins pervers, des mythomanes piteux et des utopistes délabrés, des humanitaires de la bonne conscience et des illuminés mystiques, des fanatiques religieux maniant l’Inquisition au fil du Verbe et de la machette, des imams affamés de pouvoir et des militaires d’opérette ou ayant pété leurs galons, des vieillards qui crevottent doucement sur pied et des anciens dont la sagesse est sans public, des intellectuels qui savent tout, commentent les évènements et jouent les autruches tout en conseillant aux autres d’agir… Bref un échantillon de la majorité d’entre nous qui placés dans des circonstances différentes, réagiraient de manière identique. Les femmes s’y font rares. Elles sont putes peu appétissantes, richardes déjantées et insipides, vierges d’une beauté à damner le diable et qui met dans les starting-blocks tous les fantasmes des mâles du bled, mères courage ou mères qui ont compris qu’en la
Vous vous définissez comme un homme de paix, de réconciliation et un humaniste au sens philosophique du terme. Soit. Mais votre monde, ou du moins le monde de Yasmina Khadra, est peuplé de méchants, de brutes épaisses et sanguinaires dont l’envergure mentale a le diamètre d’un petit pois ou de cerveaux bedonnants, embagousés jusqu’aux dents, fumant d’énormes cigares, avachis dans de luxueuses villas copiant le style hollywoodien de cet américanisme qu’ils envient et fustigent et dont ils souhaitent l’anéantissement, tout en recomptant sur leurs doigts boudinés les retours en bénéfices de leurs investissements sur le massacre des peuples dont ils se foutent de savoir quelle est leur religion ou la couleur de leur peau. Dans ce no man’s land du cynisme, se croisent sans se comprendre, en couches étanches et cloisonnées, des ados déboussolés, travaillés par la frustration du sexe et la folie consumériste des grandeurs, des gens ordinaires, puant la déprime et la rancune, moches, crétins, aigris, complexés, paumés, déchards (personnes vivant dans la misère), des petites frappes et des assassins pervers, des mythomanes piteux et des utopistes délabrés, des humanitaires de la bonne conscience et des illuminés mystiques, des fanatiques religieux maniant l’Inquisition au fil du Verbe et de la machette, des imams affamés de pouvoir et des militaires d’opérette ou ayant pété leurs galons, des vieillards qui crevottent doucement sur pied et des anciens dont la sagesse est sans public, des intellectuels qui savent tout, commentent les évènements et jouent les autruches tout en conseillant aux autres d’agir… Bref un échantillon de la majorité d’entre nous qui placés dans des circonstances différentes, réagiraient de manière identique. Les femmes s’y font rares. Elles sont putes peu appétissantes, richardes déjantées et insipides, vierges d’une beauté à damner le diable et qui met dans les starting-blocks tous les fantasmes des mâles du bled, mères courage ou mères qui ont compris qu’en la 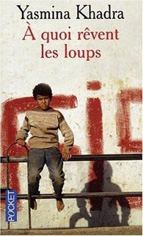 fermant, elles ont plus de chance de rester en vie, femmes reproductrices et femmes domestiques, objet d’opprobre et de mépris meurtrier pour les intégristes islamistes, prompts à les violer ou à les lapider. Elles sont souvent vieilles et asexuées de laideur comme la femme de Brahim LLod, Mina, qui n’a pas plus d’attrait qu’une remorque couchée en travers de la chaussée (!!!), et quand un héros vient à tomber amoureux, l’objet de ses vœux est souvent une femme comme tout homme en rêve, belle et sculpturale, intelligente et cultivée, une rieuse qui dévore en apparence et sous ses blessures, la vie ou… une Occidentale. La seule que j’aurais aimée serrer dans mes bras est Zunaira14. La formule que vous employez pour les femmes de votre pays, qui les ont en bronze, convient parfaitement à cette afghane, cloîtrée dans sa maison par refus de porter le tchadri que les Talibans imposent à toutes celles qui leur ont pourtant donné la vie : je refuse de porter le tchadri. Une tunique de Nessus15 ne causerait pas autant de dégâts à ma dignité que cet accoutrement funeste qui me chosifie en effaçant mon visage et en confisquant mon identité… […]… Avec ce voile maudit, je ne suis ni un être humain ni une bête, juste un affront que l’on doit cacher telle une infirmité… […]… Ne me demande pas – dit-elle à son mari Moshsen – de renoncer à mon prénom, à mes traits, à la couleur de mes yeux et à la forme de mes lèvres pour une promenade à travers la misère et la désolation ; ne me demande pas d’être moins qu’une ombre, un froufrou anonyme lâché dans une galerie hostile… Et pourtant, malgré tout ce qu’elle est, cela n’empêchera pas son mari de prendre part, quasi avec jouissance, au lynchage d’une femme dans les arènes talibanesques.
fermant, elles ont plus de chance de rester en vie, femmes reproductrices et femmes domestiques, objet d’opprobre et de mépris meurtrier pour les intégristes islamistes, prompts à les violer ou à les lapider. Elles sont souvent vieilles et asexuées de laideur comme la femme de Brahim LLod, Mina, qui n’a pas plus d’attrait qu’une remorque couchée en travers de la chaussée (!!!), et quand un héros vient à tomber amoureux, l’objet de ses vœux est souvent une femme comme tout homme en rêve, belle et sculpturale, intelligente et cultivée, une rieuse qui dévore en apparence et sous ses blessures, la vie ou… une Occidentale. La seule que j’aurais aimée serrer dans mes bras est Zunaira14. La formule que vous employez pour les femmes de votre pays, qui les ont en bronze, convient parfaitement à cette afghane, cloîtrée dans sa maison par refus de porter le tchadri que les Talibans imposent à toutes celles qui leur ont pourtant donné la vie : je refuse de porter le tchadri. Une tunique de Nessus15 ne causerait pas autant de dégâts à ma dignité que cet accoutrement funeste qui me chosifie en effaçant mon visage et en confisquant mon identité… […]… Avec ce voile maudit, je ne suis ni un être humain ni une bête, juste un affront que l’on doit cacher telle une infirmité… […]… Ne me demande pas – dit-elle à son mari Moshsen – de renoncer à mon prénom, à mes traits, à la couleur de mes yeux et à la forme de mes lèvres pour une promenade à travers la misère et la désolation ; ne me demande pas d’être moins qu’une ombre, un froufrou anonyme lâché dans une galerie hostile… Et pourtant, malgré tout ce qu’elle est, cela n’empêchera pas son mari de prendre part, quasi avec jouissance, au lynchage d’une femme dans les arènes talibanesques.
Dans votre monde, il y a aussi les villes et parfois les villages où vivent tous ces êtres, ou plutôt essaient de vivre, car la même désolation taraude Alger et Bagdad, le même effritement travaille Kaboul ou Janin, la pourriture les gangrène lentement les unes après les autres, la mort les accapare toutes et hommes et lieux finissent par se ressembler. Avec vous, le moindre rayon de soleil ignore l’innocence. On fuit les arbres, on cherche l’oxygène et la fraîcheur des mosquées finit par être accueillante. Même Paris qui se trimballe sous votre plume comme une catin ou Mexico, riche en histoire et pauvre en initiatives n’échappent à votre déprime. C’est un peu désespérant, non ? C’est l’Olympe des infortunes ! Yasmina Khadra optimiste, Yasmina Khadra humaniste ! Laissez-moi rire ! L’horreur étant humaine au même titre que le ridicule, écrivez-vous en parlant de notre millénaire, les hommes singeront l’autruche jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ainsi avance l’humanité, aveuglée par ses vanités. Les illuminés n’y verront que du feu, les astrologues des étoiles filantes. Là où s’aventureront les bonnes intentions, l’enfer leur collera au train ; là où elles élèveront des stèles, on criera au sacrilège ; là où elles dresseront des mâts de cocagne, on y taillera des gibets. Les sages n’auront de cesse de prêcher dans le désert ; les crétins puiseront leur bonheur en chaque foutaise, les génies seront évincés par d’illustres nigauds et le bras d’honneur galvanisera les foules mieux qu’un fait d’arme…
Si Yasmina Khadra représente pour beaucoup – et peut-être pour lui-même – cette dichotomie utopique quasi cellulaire qui en chacun de nous alimente notre désir que le monde soit meilleur que ce que nous en faisons, Mohamed, lui, est fragile, sans partage et lucide. De cette lucidité acérée qui perd ou sublime les hommes. Il avoue, il ose, il aime l’Homme sans en être dupe et le connaissant dans le pire, n’en espère rien dans le meilleur. Il est humaniste dans le cœur et non en esprit. Le vieux Da Achour, poète à ses heures, a parfaitement compris ce qui sépare Yasmina de Mohamed : Ton drame, dit-il au premier, est que tu as imaginé un monde merveilleux susceptible de t’aider à surmonter celui qui néantisait l’enfant que tu as été ; un monde de lumière pour conjurer le noir qui te momifiait ; un monde où le verbe du poète dominerait les acrimonies ordurières des caporaux . C’était tellement inespéré que tu as fini par y croire. Seulement ce monde là n’existe pas. Parce qu’il est le fruit de tes candeurs, il te tient à cœur. Aujourd’hui, il faut que tu t’éveilles à toi-même. Les paradis inventés par les hommes ne reflètent que l’inaptitude des hommes à supplanter les anges. La littérature n’échappe pas à cette faillite. Elle est injuste et cruelle, à l’image de ceux qui la conçoivent. Et ça, tu refuses de l’admettre. Parce que la réalité menace ton équilibr e, fausse le combat que tu as livré à la bêtise et à l’insignifiance, toi qui t’aventures à élever tes semblables au rang des valeurs que tu incarnes, toi. Il ne faut pas parier une seconde que les juste ont raison. La raison, la vraie, est un vieux rêve de Dieu. Et les hommes ne croient qu’aux rêves qui les brisent.
e, fausse le combat que tu as livré à la bêtise et à l’insignifiance, toi qui t’aventures à élever tes semblables au rang des valeurs que tu incarnes, toi. Il ne faut pas parier une seconde que les juste ont raison. La raison, la vraie, est un vieux rêve de Dieu. Et les hommes ne croient qu’aux rêves qui les brisent.
Même si je suis souvent d’accord avec vous et certains de ces êtres de chair et de sang qui traversent vos livres, j’aimerais parfois vous entendre rire, que tout ne soit pas une immense douleur ! Cela serait quand même bien que vous arrêtiez de suppurer et qu’enfin, vous cicatrisiez… pour que je puisse définitivement vous appeler Mohamed.
Tu sais quoi ? L’anonymat est souvent le garant de notre intégrité….
Cordialement, Mélanie.
PS : J’espère que vous me pardonnerez de ne pas avoir encore lu Ce que le jour doit à la nuit et Les chants cannibales.
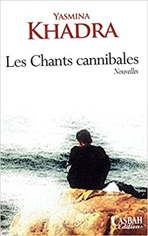
© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott – 18/10/2012
Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5
du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble
de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.
1 – L’imposture des mots, p. 136.
2 – L’imposture des mots, p. 115.
3 – La Rose de Blida, p. 68.
4 – L’écrivain, p. 203.
5 – Morituri p.13.
6 – Double Blanc, p.37.
7 – A quoi rêvent les loups, p. 75.
8 – idem, p.122.
9 – Personnage des Agneaux du Seigneur.
10 – A quoi rêvent les loups, p. 51.
11 – Les agneaux du Seigneur, p. 13.
12 – L’Attentat, p. 157.
13 – Les Sirènes de Badgad.
14 – Les hirondelles de Kaboul.
15 – Cette expression est issue de la mythologie. Blessé par Hercule, le centaure Nessus se vengea en offrant à Déjanire, sa bien-aimée, mais aussi la femme de son ennemi, une tunique sensée ramener son époux infidèle. Mais au lieu de cela, en la revêtant, Hercule se sentit consumé de l’intérieur ; une douleur telle qu’il préféra se brûler lui-même sur le mont Œta.
![]()

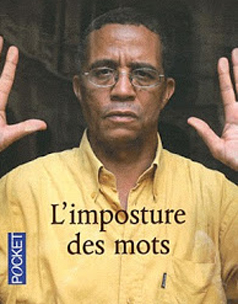
Dans l’équation africaine il écrivit quelque chose qui ressemble à ceci:…il s’est offert une belle maison ainsi qu’une belle épouse…. » (à quelque chose prés, en parlant de l’un des amis du personnage principal du livre)……ayay! aoutch ! ahhhhhhh!! tout ce que vous voulez!!!
Moi aussi, tout comme vous, je me suis mise à la lecture frénétique de cet auteur que beaucoup de mes connaissances adulait mais que je n’arrivais pas à apprécier….aujourd’hui je sais que je ne lirai plus du khadra, je trouve que j’en ai assez vu; mon impression du départ ne s’en trouve que renforcée.
J’aime beaucoup votre plume et je trouve que vous lui avez rendu un bel hommage, je reste cependant sur mes premières impressions…..quelque chose à quelque part cloche chez ce monsieur, je ne sais pas quoi mais je je suis convaincue qu’il y a anguille sous roche.
cordialement, karima
Bonjour Karima
Merci pour votre commentaire. Néanmoins, tout n’est pas à rejeter chez cet écrivain qui développe dans certains de ses ouvrages des points d’analyse intéressants à la fois sur l’actualité et la psychologie humaine, même si son mélange de style entre narration descriptive ou non et dialogues (certaine vulgarité et/ou lyrisme contre finesse) en atténue l’acuité de la lecture. Cordialement, Mélanie.
Bonjour Mélanie;
Merci pour votre réponse.
Je suis tout à fait d’accord avec vous pour ce qui a attrait à son approche par rapport à l’actualité mais en ce qui concerne la psychologie humaine, permettez-moi d’en douter. En réalité le seul vrai talent que je lui concède, les yeux fermés, est celui des métaphores. Il est vraiment très fort là dessus, je lui tire mon chapeau bien bas.
Ceci reste, bien évidemment, mon opinion et rien d’autre.
Cordialement, Karima.