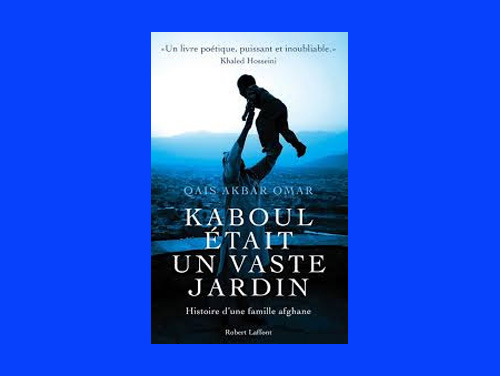II est six heures du matin, dehors il pleut, ma famille dort, un café brûle mes doigts, ma cigarette se consume. Je sens en moi cet agacement familier, précurseur d’une colère contenue. Pourquoi ce livre et aucun des trois autres que j’ai lus et où chacun des auteurs a sans doute également désiré faire toucher du cœur au lecteur ce qui depuis des décennies, a transformé l’Afghanistan en un bordel sanglant à ciel ouvert et mis ses habitants au pied de la mort ? Il manquait à La pierre de patience (Syngué Sabour) d’Atiq Rahimi de cette chair qui fait les grands livres. Il m’avait semblé, comment dire ?, falot, un peu pâlichon. Les cerfs-volants de Kaboul m’avaient laissé sur le seuil d’une réalité à qui le style trop léché de Khaled Hosseini avait au contraire quitté de la substance. Quant aux Hirondelles de Kaboul, j’y avais pressenti, à tort ou à raison, cette imposture intellectuelle opportuniste de la thématique qui traverse souvent la plupart des livres de Yasmina Khadra. En quoi Qais Akbar Omar, avait-il réussi là où les autres avaient échoué ? Lui aussi parle de l’Afghanistan, ce pays pour qui la vulgate médiatique nous a fabriqué de toutes pièces des héros de quatre sous, qu’ils soient coiffés avec le pankol couleur sable du commandant Massoud, ce dernier surhomme romantique du XX° siècle, ou avec la toque d’astrakan gris-noir d’Hamid Karzai, nouvelle égérie de l’hégémonie capitaliste libérale, ce pays qui ne résonne à notre mémoire que martyrisé par l’horreur talibane ? La réponse était là, dans les mots de ce jeune homme qui ne cherchait pas à faire œuvre d’écrivain ni à gagner un prix littéraire ou la notoriété. Comme il l’a spécifié dans une interview, « parler du passé était la meilleure façon de soulager la peine de son âme. » Et il le fait avec ses tripes, pas avec sa tête. Il ne raconte pas seulement son histoire, mais celle de tout un peuple en errance, ces histoires banales des gens ordinaires captifs de conflits mortifères, armés par les intérêts biaisés de minorités fluctuantes et puissantes qui misent sur l’ingérence économique ou idéologique pour faire tourner leur planche à billets, imprimés à l’encre du sang des autres. Trop jeune pour avoir connu l’occupation soviétique, Qais Akbar Omar trempe sa mémoire dans la clameur qui en 1992, enflamma Kaboul lorsque les Moudjahidines y entrèrent au cri d’Allah Akbar. Bientôt, ce cri allait être étouffé dans le chaos et la sidération collective dans laquelle allaient sombrer les Kaboulis. Chaque faction – les Patchouns, maîtres du pays depuis 1747, dont le célèbre commandant Massoud qui ne fut pas en reste de cruauté gratuite, les Tadjik, les Ouzbèkes ou encore, les Hazaras, honnis de tous – mit la ville en coupe réglée. Chacune son territoire, ses seigneurs de la guerre fanatiques, ses bandes sanguinaires de pilleurs, de violeurs et d’assassins, toute prison ouverte, ses check points, ses tirs de roquette, ses snipers et sa barbarie. La faim, la mort gratuite, la vie qui ne vaut plus rien.
Et cette question récurrente qu’on ne peut manquer de se poser : que ferais-je, que ferions-nous si cela nous arrivait demain, ici, dans nos démocraties obèses de tous nos droits et vérolées de toutes ces trahisons tellement acceptables et acceptées que l’on ne voit même plus leurs significations et encore moins leurs conséquences ? Partir ? Rester ? Subir ? Fuir ? On revient toujours à l’essentiel, sauver sa peau et celle de tous ceux que l’on aime au prix de sa propre vie. La leur résume la nôtre.
C’est cet exil intérieur dans un Afghanistan qui déjà n’existe plus que nous fait partager l’auteur, un voyage quasi initiatique pour cet adolescent structuré et guidé par la personnalité emblématique de son grand-père. Un homme qui ne doit en rien sa réussite au privilège d’être patchoun, puisque né dans une famille besogneuse d’éleveurs de chèvres et de chameaux, mais à sa volonté farouche de rester maître de sa vie, quoiqu’il advienne. Il aime son pays comme il aime sa famille. Sans partage, avec rigueur et bonté, soucieux de les protéger envers et contre tout, malgré eux. Il est l’aïeul de tout le monde, le Guardi Guedj qui traverse Les cavaliers de Kessel. Celui qui sait voir en chaque individu les fissures sous le turban ou le tchadri. Qu’importe qu’il soit devenu ceci ou cela, fin connaisseur en matière de tapis, commerce repris actuellement par notre jeune auteur. Pour lui, seule l’éducation peut vaincre l’ignorance. Seule l’éducation peut faire la nique aux ordures idéologiques que l’on nous refourgue comme des miettes de liberté. C’est ce qu’il transmet à ses enfants et à leurs enfants. Chez lui, table est mise quotidiennement pour son clan, une quarantaine de personnes, rires, larmes, repas formidables, pique-niques familiaux dans les environs de Kaboul où jusqu’au crépuscule, les cerfs-volants veillent sur la ville, en compagnie de poètes, Rumi, Hâfiz ou Omar Khayyam, mais aussi de Dostoïevski, Tolstoï, Freud ou Thomas Mann. Les femmes et les filles y sont conviées non voilées, au même titre que les hommes et les garçons. « Les hommes véritables ne meurent pas de la mort ; la mort trouve sa mort en l’homme. Les hommes véritables ne meurent pas de la mort ; la mort trouve son nom chez l’homme. Quand le nom d’un homme est respecté, alors la mort n’a pas de nom … », dit-il. Qu’il soit petit ou grand, Patchoun ou Hazara, musulman ou non, il explique à celui qui veut bien l’écouter, qu’être vivant, même moulu par la vie, c’est d’abord et avant tout rester éveillé, être lucide et avoir la mémoire des choses. Il leur enseigne que rien n’est jamais acquis si l’on s’en remet à la loi terrible des hommes, mais que tout peut l’être si l’on a foi en soi. Et son petit fils lui doit certainement ce regard curieux, attentif et tendre qu’il porte sur cet Afghanistan, si loin et si proche des fureurs guerrières, celui que les images de Roland et Sabrina Michaud ont rendu pérenne, un Afghanistan où le sens de l’hospitalité, les coutumes et les traditions tissent des rencontres inoubliables dont l’auteur sait nous transmettre la richesse et l’intensité sans sensationnalisme ni analyse à deux balles du problème afghan. Un Afghanistan disparu. Un long périple pour se retrouver finalement, autour du grand-père, de nouveau tous à Kaboul sous la botte talibane de jeunes moudj, hirsutes, puants, au regard déjanté, brouillé par la came ou l’alcool. La vie n’y vaut rien et tient parfois stoïquement à la longueur de vos poils sous les aisselles ou plus surréaliste, à ceux de votre pubis… Pas la bonne longueur et hop ! Direct en tôle pour le plaisir sexuel des soldats d’Allah. Les exemples donnés par l’auteur sont un florilège ahurissant de connerie !
Et aujourd’hui ? La barbarie talibanesque a été éjectée au profit « d’étrangers plus intéressés par leur propre politique que par notre pays. Ils chassèrent les talibans pour un certain temps. Mais ils ramenèrent les même factions qui s’étaient proclamées moudjahidine et avaient détruit notre pays…[…] De nombreux étrangers qui avaient déclaré être venus pour nous aider repartirent très riches… […]… Quand je vois les sommes d’argent gaspillées par les étrangers, je pense à mon grand-père…» et écrit Qais Akbar Omar à cette fable que lui a raconté son grand-père au sujet du Mollah Nasruddin : « il habitait un village pas loin d’ici. Chaque matin, il se rendait à dos d’âne dans un lieu où personne ne va jamais. Pourquoi l’auraient-ils fait ? Dieu avait créé cet endroit pour nous montrer ce qu’est un terrain vague. Au bout d’un certain temps, son voisin Ali Khan devint de plus en plus curieux de connaître la raison de ces déplacements quotidiens. Trop respectueux pour lui poser directement la question, il envoya l’un de ses fils lui demander s’il pouvait faire quelque chose pour améliorer la vie du mollah Nasruddin. Ravi de voir le fils d’Ali Khan, le mollah lui offrit un bonbon… […]… Le garçon déclina l’offre poliment. Puis le mollah lui demanda : “Pourquoi es-tu seul ? Où sont les autres ?” Le fils d’Ali Khan demanda à son tour au mollah : “Qui attendez-vous ? — Écoute, répondit le mollah, un jour quelque chose de bien peut se produire ici. Si c’est le cas, une foule s’y rassemblera, et comme je suis là le premier, expliqua-t-il avec son fameux sourire, j’aurai la meilleure vue du spectacle. D’ici là, j’attends. »
Alors oui, la dernière page lue, dans ce matin frisquet et confortable où lire est un luxe, la colère gronde en moi. Constater comme ici on laisse la démocratie pourrir à petit feu en polémiquant sur les réseaux sociaux – un coup à droite, un coup à gauche et peut-être qu’on devrait essayer les extrêmes afin de voir si on se porterait mieux sans en bouger une ! – quand d’autres la désirent tant, me fout la honte. Ici, privilégiés que nous sommes, on ne se bat plus que pour décrocher un crédit. Lyophilisés jusqu’à la moelle, les neurones pasteurisés et le cœur transgéniqué, on laisse pisser. C’est ce qu’il y a, on ne peut rien faire ou pire encore, il faut faire avec ! Et la valse des clowns continue… Il y a quelques jours encore, on adulait de nos lâches et labiles applaudissements une démocratie grecque qui n’en a plus que le souvenir culturel. Là-bas, mais c’est si loin, d’autres se font battre à coups de fouet, lyncher ou décapiter pour elle. Les victimes du fascisme et du nazisme – entre autres – peuvent continuer à roupiller tranquilles dans leur cimetière. Peu de chance que ce pourquoi ils sont morts viennent perturber notre facilité à zapper ce qui nous incommode. La peur en nous creuse déjà ses tranchées. Nous sommes des vaches qui regardons passer les trains. C’est vrai. On peut gagner une guerre et perdre la paix. Oui, Kaboul était un vaste jardin. Mais il est également celui qu’on est en train de paumer ! Le livre de Qais Akbar Omar en écrit peut-être l’épitaphe.
© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott – 21/07/2015
Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5
du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.
![]()