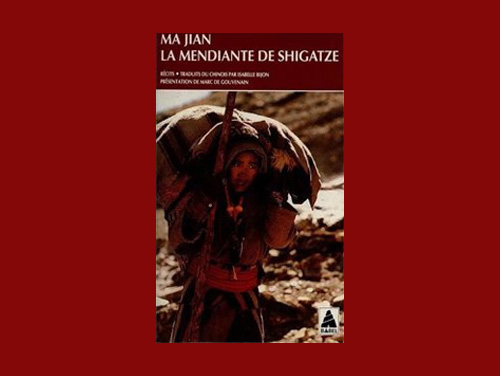La mendiante de Shigatze (recueil de cinq nouvelles) nous plonge dans un Tibet aussi oppressant qu’oppressif et dans les us et coutumes d’un peuple violent, rude, bien loin du froufrou safrané des monastères, bastions d’une sagesse codifiée, rigoriste, assassine et misogyne. Un Tibet fort éloigné de ce pays fantasmé, non seulement destiné à se fondre par la subordination à tout crin dans la grande Chine, une fois désinfectés son folklore et ses traditions, mais aussi à l’opposé de l’idée fascinée qu’en ont généralement les Occidentaux dont celle de son pacifisme vertueux et victimaire, a contrario de ce que nous enseigne l’histoire tibétaine. Des siècles durant, ce fut un peuple de conquérants, de redoutables guerriers et de non moins excellents stratèges qui perdit peu à peu son autonomie et finalement en grande partie suite aux manigances de l’Empire Britannique.
Une terre rude incline rarement ceux qui y vivent à la compassion, caractéristique qui n’est nullement spécifique au Tibet dont Ma Jian décrit non sans talent les paysages majestueux et désertés des hommes. Néanmoins, la vision, parfois glauque, qu’il en donne, heurtera sûrement ceux qui enrobent le Tibet dans une imagerie pseudo-mystique de toges rouge vermillon, de monastères et de « chevaux du vent », d’autant plus que les femmes, et c’est une évidence malheureusement planétaire encore aujourd’hui, en sont les tristes messagères. Quel que soit le lieu où l’on se tourne, ici, là ou ailleurs, Dieu, qu’il soit omnipotent dans sa multiplicité ou sa singularité, est toujours mâle dans ses prérogatives divines comme l’homme l’est dans ses désirs.. La femme se doit d’écarter les jambes afin que Dieu ou son représentant sur terre puisse crever le plafond de la nébuleuse divine dans une éjaculation cosmique et que l’homme, quant à lui, qu’il soit lama, moine ou simple quidam, puisse y oublier qu’il n’est que ce qu’il est, un dévot soumis à sa propre nature humaine, qu’il se doit de satisfaire par le viol ou l’inceste. La pauvreté et l’inculture n’ont rien à voir là-dedans. Aux traditions et croyances multi-millénaristes, se substitue aisément la physiologie hormonale, bien moins exotique, des individus.
Au bout du compte, ce qui surprend le plus dans La mendiante de Shigatze ne sont pas les faits rapportés, mais plutôt leur caractère universel. Les funérailles célestes que Ma Jian désire photographier, puisqu’il est aussi photographe, rappelle les Tours du Silence, les Dakma du rite zoroastrien. La Dakini, déesse qui possède des connaissances secrètes et marche dans les airs et apparaît au cours de la méditation, renvoie à la puissante Darhini des Roms, la sorcière qui connaît les plantes, a le don de clairvoyance, pratique l’hypnose et la télépathie et dialogue avec les trois anges qui apparaissent lors de la naissance d’un enfant. Le rituel sexuel bouddhique où un maître (larang) viole publiquement une jeune fille pour « parfaire ses deux corps masculin et féminin », avant qu’elle soit mise cruellement à mort, a de quoi vous donner envie de déboulonner la statue du jeune Bouddha Jowo du temple du Jokhang et d’envoyer aux pelotes son éternel sourire bienveillant, fait écho à l’antique prostitution sacrée dans le Proche Orient ancien, celle des Dévadâsi en Inde, ou encore les pratiques rituelles de la hiérogamie, union d’un homme et d’une femme, symbolisant celle de deux divinités.
Comme Ma Jian le souligne : « Mon humour est plus que noir, il est rouge… de sang ».
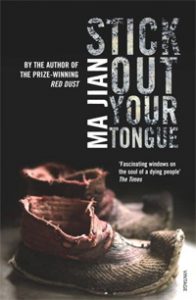
Extrait :
…] … J’ai tété ma mère jusqu’à l’âge de quatorze ans. Son lait ne s’était pas tari. Mon père avait été tué pendant le soulèvement contre les Chinois. Dans nos steppes, il n’y a pas grand monde, tu verras quand tu y arriveras. A seize ans, j’ai couché avec ma mère. J’avais pourtant l’occasion de fréquenter d’autres femmes quand j’allais au chef-lieu du canton, chaque année pour la Fête du Yaourt ou bien pour faire tondre mes moutons. Mais mes sentiments n’étaient pas clairs. Et puis, je ne pouvais pas me passer de ma mère. Çà la faisait pleurer des fois mais je n’y pouvais rien, elle non plus. J’étais son homme, elle m’avait élevé. Après la mort de mon père, elle ne s’est plus occupée que de moi. Elle n’a jamais eu d’autre homme, pas même un berger de passage.
Un jour où je me trouvais à Djiwa, j’appris que la lamasserie de Sera allait faire restaurer ses bouddhas en bronze. C’était l’occasion de quitter ma mère et de me rendre à Lhassa.
A l’époque, ma fille avait déjà neuf ans. Qu’aurait-elle fait si elle avait su que sa mère était également la mienne ? … […]
© L’Ombre du Regard Ed., Mélanie Talcott – 26/02/2020.
Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle,
ne peut être faite de l’ensemble de ce site sans l’autorisation expresse de l’auteur.
![]()